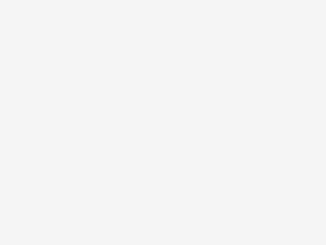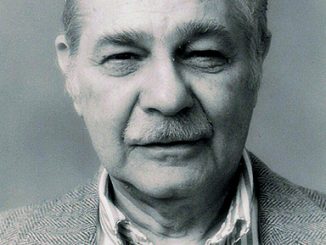« Le pape, combien de divisions ? » ricanait Staline. Or, l’État du Saint Père a survécu à celui du Petit Père des Peuples. La bonne question était peut-être : « Le communisme, une foi pour combien de siècles ? »
« Le pape, combien de divisions ? » ricanait Staline. Or, l’État du Saint Père a survécu à celui du Petit Père des Peuples. La bonne question était peut-être : « Le communisme, une foi pour combien de siècles ? »
L’idéologie [1] est-elle un facteur de puissance, mesuré au nombre des partisans, cette chair à canon de l’idéal ? Est-ce une arme collective – elle demande des servants – même si c’est une arme spirituelle ? Par sa capacité de mobiliser des croyants, de recruter des alliés et de culpabiliser des adversaires, elle appartiendrait alors aux panoplies de puissance comme territoire, population, ressources économiques et militaires….
D’autres objecteront que l’idéologie est par nature délirante, qu’elle déforme notre perception du monde, nous assigne des buts impossibles et, finalement, mène à l’échec donc à la perte de puissance.
Ou encore que l’idéologie, c’est l’hostilité – doctrine contre doctrine, rêve contre rêve – qu’elle nous dresse les uns contre les autres, et, qu’au final cet affrontement est un jeu perdant/perdant.
Chacune des trois thèses, avec sa part de vérité, puisque chacune est une des facettes de l’idéologie.
Elle a fonction d’explication : elle fournit un paradigme et des catégories pour interpréter la réalité ce qui la rend à la fois déformante, simplifiante, attirante et rassurante.
Elle a une fonction de propagation : elle dit où est le bien et où est le mal et recrute des prosélytes qui la répandront à leur tour. Cela la rend contagieuse mais aussi discriminante : des communautés animées par leurs croyances tendent à s’opposer. Toute idéologie suscite sa contre-idéologie.
Enfin l’idéologie transforme. C’est un discours sur le monde tel qu’il doit devenir (cela, c’est sa part d’utopie) ou qui dit pourquoi il doit rester tel qu’il est (elle légitime). Mais c’est surtout un discours disant comment ce monde doit advenir ou se maintenir. Elle vise à l’action par un minimum de stratégie et une vision de l’histoire.
Nous ne pouvons cependant nous contenter de cette réponse syncrétique, pour au moins trois raisons :
– L’idéologie n’est pas « en option ». Nul ne choisit ou bien l’idéologie ou bien le réalisme pour accroître la puissance.
– L’idéologie ne tombe pas du ciel, ni n’est simple reflet spirituel de la situation matérielle. Elle jouit d’une certaine autonomie ; ni son succès ni son échec ne sont inscrits dans les étoiles.
– L’idéologie vit : elle passe par certains cerveaux et par certains canaux. Et se transforme au cours de cette opération. C’est un processus pas une chose.
I-Le réel, l’idéal, l’idéologie
« Une idéologie est un complexe d’idées ou de représentations qui passe aux yeux du sujet pour une interprétation du monde ou de sa propre situation, qui lui représente la vérité absolue, mais sous la forme d’une illusion par quoi il se justifie, se dissimule, se dérobe d’une façon ou d’une autre, mais pour son avantage immédiat »[2] K. Japsers
La géopolitique distingue la puissance de l’influence. La puissance accumule des moyens de faire (territoire, industrie, finance, armées, technologie…). Ils peuvent ou bien rester potentiels («en puissance ») ou bien se mesurer à une résistance, une autre puissance sous forme de contrainte. Quant à l’influence, c’est un moyen de faire faire à autrui (par séduction, prestige, persuasion, réseau, alliance…) : elle n’est pas virtuelle et ne stocke pas ; elle se révèle en s’exerçant. L’influence se manifeste à la probabilité qu’un autre acteur vous imite ou agisse conformément à vos souhaits et intérêts. Elle ne se connaît qu’à ses résultats et ceux-ci ressortent mystères de la pragmatique, art d’agir sur les gens, non de la technique, manière d’agir sur les choses.
La propagation d’une idéologie serait dans cette acception le couronnement d’un mécanisme d’influence. Corollairement tout processus d’influence tendrait à intégrer une composante idéologique, en ce qu’il modifie les critères d’évaluation de l'influencé. Au moins en paroles : les pays de la « zone d'influence soviétique » haïssaient le grand frère et ne lui obéissaient sans doute que par peur. N'empêche que, chaque fois qu'ils s'alignaient sur Moscou, ils justifiaient cette attitude au nom de valeurs universelles et d'une science totale du réel, le matérialisme dialectique historique.
L’idéologie/influence prolonge la puissance. Il semble logique de croire qu’en politique étrangère, plus les populations ou les gouvernements acceptent les valeurs que vous incarnez, plus ils partagent vos analyses et vos croyances, plus ils adhérent aux buts que vous proclamez, plus cela sert vos intérêts : vous trouvez plus facilement des alliés dans les guerres, davantage de marchés s’ouvrent à vous, vos actions diplomatiques recueillent de meilleurs soutiens, etc.
De ce point de vue, la Guerre Froide était un idéal-type. Tous les progrès du marxisme et de l’anti-impérialisme dans les mentalités réjouissaient le camp du socialisme. Mais le camp occidental ne négligeait pas la lutte idéologique et culturelle, du moins pas toujours. Sous Eisenhower, ce fut la guerre culturelle (répandre le jazz et la peinture abstraite au-delà du rideau de fer), « pour le cœur et les esprits », la « diplomatie publique », censée donner une bonne image de l’Amérique et répandre les valeurs de liberté. Sous Reagan le combat pour les idées et les valeurs (et pour leur diffusion à l’Est) était un thème constant.
En règle générale, les réalistes prônent volontiers une politique débarrassée de l’idéologie et dont le seul but serait l’accroissement de sa puissance. Pour eux, l’idéologie ne peut être que le masque de l’intérêt, de beaux discours qui dissimulent des desseins cyniques. Ou alors, elle devient un frein à la puissance, un fatras de considérations morales qui exercent une emprise sur les dirigeants (via les médias et l’opinion) et les empêche de poursuivre leurs buts par tous les moyens. Mais dans l’idéologie, ils ne voient que l’idéalisme.
L’idéologie contribue d’abord à nous dire où sont nos intérêts et quels buts « réalistes » nous devrions poursuivre et faire coïncider avec les valeurs. Comme l’ont souligné des chercheurs de l’école « constructiviste »,[3] nos croyances normatives déterminent aussi ce que nous pensons être notre intérêt national, ou notre perception de la force et des rapports de puissance.
Par ailleurs, rien de plus idéologique que de se réclamer du principe de réalité. Dans le marxisme, c’était lui qui garantissait, via les lois de l’Histoire, le triomphe du socialisme.
Dans le néo-libéralisme, l’indépassable réalité borne le domaine de l’action humaine (c’est ainsi… telles sont les règles de la mondialisation, les lois du marché). Même l’altermondialisme et l’écologisme interprètent ce principe: ça ne peut plus durer, l’utopie néo-libérale nous mène dans le mur, l’environnement (ou les nécessités de la vie sociale) imposent des bornes à la marchandisation du monde.
Enfin et surtout, les rapports entre puissance et idéologie ne sont pas unilatéraux. L’idéologie est nécessairement discours sur la puissance. Souvent, pour en décrire la genèse. Toujours pour dire si elle est légitime. Pas de puissance de l’idéologie sans idéologie de la puissance.
On se souvient du bruit que fit peu avant la guerre d’Irak le livre de Robert Kagan « La puissance et la faiblesse ».[4] L’auteur reprochait aux Européens leur refus de recourir à la force. Il les décrivait comme les jobards, victimes de l’illusion « kantienne » d’un monde régi par le droit, donc d’une illusion idéologique molle. Leurs faibles capacités offensives et la carence leur volonté se déguiseraient en discours ronflant. Kagan y opposait la Machtpolitik, la politique de puissance sans complexe U.S.
Or depuis, le même Kagan, instruit par l’expérience, rend hommage à ce qu’il méprisait [5] tant les U.S.A. se révèlent incapables de gagner une influence à la mesure de leur puissance. Dans la mesure où ils prétendent exercer leur leadership au nom de valeurs universelles, ils ont désespérément besoin du consensus du monde libéral. Et cette légitimité, l’Europe tendra de plus en plus à la lui refuser D’une part, faute de la même perception des périls : les U.S.A considèrent que toute leur stratégie est polarisée par ce que certains nomment « quatrième guerre mondiale »,[6] pas les Européens. D’autre part, le principe même de prééminence sans contrôle contredit la philosophie des libéraux.
Ce revirement rappelle :
a) – que l’idée de l’un reste toujours l’idéologie de l’autre,
b) – que l’idéologie peut autant être une incitation à user de la force (notion que Kagan confond visiblement avec celle de puissance) qu’un alibi de la faiblesse et
c) qu’elle revient au galop (à supposer qu’elle soit jamais partie !).
Nous avons vécu le soulagement postmoderne : chute de l’empire soviétique et fin des utopies conquérantes. Il y eut la « mélancolie démocratique »,[7] l’ennui de ne plus avoir d’ennemi. Il y eut un moment l’enchantement [8] de la communication : les technologies de l’information, remède à l’incertitude et au conflit, devaient unir notre village global Mais il a fallu déchanter. Le mythe de la « fin des idéologies », après une première mode dans les année 60/70,[9] a été balayé au tournant du millénaire.
Nous-mêmes parlions la « soft idéologie »[10] dans les années 80 : la conception dominante, mélangeait valeurs individualistes, et abandon à la force des choses. Elle croyait au triomphe des 4 M. Le Marché. La Mondialisation. La Morale (droits de l’homme, tolérance et bonne gouvernance). Les Médias (et en particulier les Nouvelles Technologies de la Communication).
Ce que d’autres appelaient domination de la pensée unique se révélait n’être ni unique ni dominante. Elle se heurtait d’abord à une double contestation. La première était « archaïque », identitaire, voire djihadiste : l’opposition violente à une modernité et à une universalité assimilées à une occidentalisation impérialiste
La seconde contestation était anti ou alter mondialisation. Elle était souvent brillante dans sa critique du Système et faible dans ses propositions, toutes basées sur le principe du « autrement » et du « un peu » : conserver un peu de puissance publique et de droit international, garder des valeurs non-marchandes, gouverner autrement.
Second temps, après le 11 Septembre, la mondialisation heureuse tourne en démocratisation tragique : la terreur, puis la guerre à la Terreur [11] et l’extension au besoin par la force, d’un modèle occidental. De là le succès de la thématique des néo-conservateurs, cette nouvelle idéologie de la Bonne Puissance.
Or aujourd’hui elle échoue visiblement que ce soit son volet militaire (unilatéralisme, guerre préemptive contre les États voyous, terroristes et/ susceptibles de se doter d’ADM) ou son volet démocratique (démocratise le Grand Moyen Orient, assécher les sources du terrorisme qui sont les tyrannies et l’obscurantisme.
Les néo-conservateurs surévaluaient – La faiblesse intrinsèque des dictatures. En cela, ils ont appliqué un schéma de guerre froide : si l’Amérique se montre assez ferme face à l’URSS, par exemple dans les négociations sur le désarmement nucléaire et l’option double zéro, l’Empire du Mal recule. Si l’Amérique aide les mouvements de lutte armée comme en Afghanistan, ils l’emportent.
– L’attractivité des démocraties libérales. Les néos ont raisonné comme si tout homme raisonnable, pourvu qu’on le libère de la crainte et de la propagande mensongère, ne pouvait que désirer la liberté à l’américaine. Or ni le formalisme juridique, ni les millions de dollars consacrés au « Nation Building », ni la présence de GI Joe ne garantissent que la population désire spontanément instaurer un régime à l’occidentale.
Elle peut décider de porter au pouvoir le Hamas, les conservateurs iraniens, les partis religieux chiites…
– Le danger terroriste et sa perception. Si le terrorisme islamiste est toujours capable, bon an mal an, de produire son lot d’attentats spectaculaires, il est contre-productif de faire d’al Quaïda l’ennemi principal du genre humain. Au contraire la lutte contre le terrorisme peut devenir une prophétie auto-réalisatrice : l’Irak, un des rares pays qui était indemne devenu ce sanctuaire du jihadisme et ce camp d’entraînement des mouhadjidines de tout poil que l’on dénonçait à tort avant 2003.
– Le prétendu sens de l’Histoire. Les formules ronflantes du type « agenda révolutionnaire » ou « tsunami démocratique », l’extension du système occidental démocratique à la planète, sont restées sans effet.
Corollairement, ils ont sous-estimé :
– Le facteur culturel. Tout Autre n’est pas un Américain qui s’ignore. Aussi difficile que cela soit à comprendre pour quelqu’un qui travaille entre K Street et le Potomac, l’anti-américanisme qui a atteint des sommets inégalés a progressé non pas malgré mais à cause de la politique d’hégémonie bienveillante et de « globalisme démocratique ».
– Les résistances internes à leur politique : l’opinion US depuis le temps qu’on la décrit comme « traumatisée par le 11 Septembre » n’est plus prête à accepter tous les sacrifices.
– Les résistances des alliés. À trop s’imaginer que seule pouvait renâcler une bande de lopettes pacifistes et pinailleuses croyant en l’efficacité des résolutions de l’Onu, et à trop croire que la réussite leur donnerait raison, les faucons ont négligé que l’opposition à la guerre d’Irak reposait aussi sur la critique justifiée de ses résultats.
N’avoir ni légitimité ni efficacité n’est pas un résultat enviable.
– Et, last but not least, les résistances des adversaires. Là encore, aussi étrange que cela soit, ces types un peu basanés ont tendance à se battre plus vigoureusement pour leur terre et leur foi que les apparatchiks pour leurs privilèges et leur Lada.
La pensée néo-conservatrice semple avoir rempli toutes les fonctions discernées par la critique de l’idéologie et ce à un degré extrême :
– Occultation des intérêts des élites dirigeantes américaines (dont le destin prétend se confondre avec l’assomption d’une nouvelle ère de l’humanité). Mais aussi des néo-conservateurs eux-mêmes : leur pouvoir tient dans la faculté de convaincre les dirigeants du « pouvoir des idées »,[12] donc du leur.
– Transposition d’une situation éphémère et historiquement déterminée (l’absence de véritable compétiteur à la puissance américaine) en lutte des principes éternels. Toute idéologie tend à hypostasier la situation de celui qui l’énonce en vérités éternelles ou enjeux éthiques fondamentaux.
– Traduction des passions en idées : justifier en droit et en morale une volonté de puissance sans ambiguïté et des appétits sans partage.
Mais, plus frappant encore, l’idéologie néo témoigne de cette émancipation de l’expérience.:
– Comme système de simplification du monde faisant rentrer sa diversité dans des catégories prédéfinies (et faisant précéder toutes les questions de leur réponse – Comme système de projection, c’est une véritable machine à fabriquer des ennemis.
Plus on veut rendre les autres semblables à soi, plus on leur offre un objet de haine.
Mais, même si les observateurs annoncent un retour des « pragmatiques » ou des « réalistes » à Washington, le fait que l’idéologie néo-conservatrice ait échoué de façon quasi « soviétique » ne nous garantit en aucune façon qu’elle s’amendera, déclinera ou disparaîtra.
II-L’autonomie des idées
« Une idéologie est précisément ce que son nom indique : elle est la logique d’une idée… L’émancipation de la pensée à l’égard de l’expérience. » Hannah Arendt [13]
Sommes-nous maîtres de nos idéologies ? Quelle rapport entretenons-nous avec ces productions de nos esprits ? La question est au cœur de la définition. D’abord conçu de façon neutre comme une science de la production des idées par Destutt de Tracy,[14] le mot idéologie a pris un sens péjoratif, voire pathologique. L’idéologie serait une maladie hallucinatoire de l’idéal, une projection imaginaire de ceux qui n’ont pas la lucidité ou le courage d’affronter le réel tel qu’il est. C’est en ce sens qu’on l’emploie dans la vie courante. Généralement pour en accuser son adversaire (« L’idéologie, c’est l’idée de l’autre » disait Raymond Aron) et pour s’en déclarer indemne. C’est-à-dire suivant le cas pragmatique, réaliste ou scientifique. Ce serait, au fond, un produit du sommeil de la raison, une aberration. Mais cette première vision de l’idéologie tombée du ciel des idées, ou y projetant les rêveurs, ne permet guère d’en comprendre les mécanismes.
Tout naturellement, la critique des idéologies devient soupçonneuse : que traduisent et que manifestent-elles ? La notion pourrait renvoyer à autre chose qu’elle-même, dont des intérêts d’autant plus matériels qu’elle est idéelle. Le grand mot est lâché : l’idéologie « justifie ». Les penseurs marxistes, en particulier, se débattent longtemps avec le concept d’idéologie qu’ils peinent à distinguer de celui de fausse conscience. C’est le « processus que le soi-disant penseur accomplit sans doute consciemment, mais avec une conscience fausse (et où) Les forces motrices véritables qui l’agissent lui restent inconnues » suivant la formule d’Engels.[15]
Ou, selon une image plus célèbre encore, l’idéologie donne une image du réel, mais une image « renversée » comme dans une chambre obscure. La tâche du bon matérialiste serait d’en révéler la « base réelle ». Occultant les conditions de sa propre production, une pensée idéologique ne serait pas une erreur telle qu’une preuve contraire ou un bon raisonnement suffirait à dissiper. Ce serait la traduction d’une situation historique, la représentation nécessairement partielle et partiale que chacun se fait du processus historique dans une relation entre dominants et dominés. L’idéologie n’est donc pas arbitraire du point de vue de celui qui la professe et se persuade de sa validité universelle. Elle est tout à la fois un manque (elle déforme le réel) et un indice (chacun se représente ledit réel en fonction de sa position).
Faire une glose de la pensée marxiste sur ce sujet n’aurait aujourd’hui qu’un intérêt archéologique. Sans compter les divergences : le marxisme « vulgaire », l’école de Francfort, Lukacs ou Althusser ne professent visiblement pas la même conception de l’idéologie. Plus révélateurs, sont les problèmes que ces tentatives théoriques ont indirectement soulevés.
D’abord celui de la véracité ou de la vérité de l’idéologie : pourquoi certains penseurs échapperaient-ils à la malédiction du faux pour se mettre à produire des idées « vraies », telle une critique « vraie » des idéologies ? Qui produirait de la non-idéologie ? Une classe dont les intérêts (c’est-à-dire le besoin de libération) seraient universels, donc la pensée universellement vraie, le prolétariat ? Des intellectuels à qui leur position permet de se [13] distancier suffisamment comme le pensait Karl Mannheim ? les penseurs « scientifiques » et post idéologiques dont Althusser prétend être le prototype ?
La diversité de l’idéologie s’oppose tout autant aux tentatives déterministes. Tantôt sous forme de l’idéologie dominante, elle est la vision heureuse et fixe, non-historique, qu’un groupe se donne d’une réalité contingente et transitoire. Barthes voit même dans le fait de « farder les choses en nature et en éternité »[16] le processus idéologique par excellence qui explique que le monde ne saurait être autrement qu’il est et en gomme les contradictions. Tantôt l’idéologie semble s’imposer d’en haut à ceux qu’elle mystifie et à qui elle occulte leur propre situation de dominés (c’est très grossièrement résumé ce que dit Gramsci). Tantôt encore, l’idéologie prend la forme de l’utopie, expression détournée d’une espérance en un autre ordre possible, contradiction qui pose problème, notamment à l’école de Francfort.
Autre objet de débat : la coexistence entre une idéologie globale qui se confond quasiment avec la culture ou avec l’ensemble des représentations et jugements partagés par les membres d’une société d’une part, et, d’autres part, des idéologies partielles qui se combattent. Elles le font souvent en tentant d’idéologiser une notion déjà bien accepté dans une société donnée, un principe juridique ou une loi scientifique : elles le mettent au service de leurs desseins et propositions.
La seule façon d’échapper à tant de dilemmes consiste à reconnaître le caractère stratégique, conflictuel de l’idéologie. Une idéologie, c’est une famille d’idées qui combattent d’autres familles, s’adaptent et se transforment dans ce processus. La partie épistémique de l’idéologie, instrument d’une explication ou d’une pseudo explication du réel, n’est pas séparable de partie programmatique : la volonté de traduire des valeurs en réalité. Il faut concéder une forme d’autonomie relative à l’idéologie.
Cette pensée-Frankenstein échappe toujours peu ou prou à son créateur. Et d’ailleurs, comme le monstre du roman de Mary Shelley, n’est-elle pas un peu faite de morceaux de cadavres ? Elle est composée d’idées mortes plus anciennes qui retrouvent vie dans un nouvel ensemble. Elle est peu ou prou « bricolée » au sens où Lévi-Strauss parle de la pensée sauvage comme d’une « bricolage », d’analyse et d’imaginaire, qui fait avec les moyens du bord… L’idéologue bricole jugements de valeurs, faits, projets, notions admises et innovations. Il fait des compromis entre habileté rhétorique ou recherche de l’efficacité et respect de ses propres postulats.
Ni totalement délirante, ni simple « traduction » de la situation de qui l’énonce, l’idéologie remplit des fonctions difficiles à concilier : forger l’identité d’un groupe, lui rendre le monde intelligible, réfuter des explications concurrentes, rassurer et mobiliser. Tout dépend également des rapports de force et de ce que nous pourrions appeler, pour rester dans la métaphore écologique, « environnement » de l’idéologie. Ainsi, la capacité que possède une idéologie de nier la réalité semble particulièrement élevée dans deux situations opposées : quand son énonciation ne rencontre aucun obstacle (quand, par exemple, les discours rivaux sont réduits au silence), mais aussi quand l’idéologie est très minoritaire et qu’elle compense en rigidité sectaire ce qu’elle n’a pas gagné en extension populaire.
L’exemple le plus évident du premier cas est celui du système soviétique. Alain Besançon le décrivait justement comme une « idéocratie ». Idéocratie non seulement parce que les représentations idéologiques commandent la pratique politique, mais aussi en un sens plus précis. Comme la gnose dévoile derrière le monde réel un monde qui lui est immanent, l’idéologie veut contraindre, au besoin par la terreur, chacun à proclamer que ce qui doit être est effectivement : « Le régime idéologique déploie l’essentiel de son activité terroriste à faire croire au monde, à ses sujets, à ses agents que l’essentiel du cosmos social est déjà transfigurée, qu’avec le socialisme, l’humanité est actuellement entrée dans son état définitif… Il faut que la portion de la réalité qui se trouve sous le contrôle du régime soit traitée comme une non-réalité et la pseudo-réalité comme la réalité. »[17]
L’autre cas de figure est inverse : l’impuissance à changer les choses, et surtout les gens, fait bon ménage avec la propension à les rêver. Plus on est groupusculaire, plus on est autoritaire, moins on a prise sur le réel, plus on le sublime. Entre les deux se situe l’ordinaire de nos jours; les compromis que nous passons tous entre l’idéalité et la réalité. Pas plus qu’on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas avoir d’idéologie, même en proclamant la thèse de la fin des idéologies. Comme le dit Edgar Morin « Les grandes idéologies nous possèdent autant que nous les possédons et cette existence mythique fait partie de la l’existence sociale ainsi que de nos existences individuelles.»[18] Nous oscillons entre le confort que nous offrent les préjugements idéologiques, la cause qu’ils offrent à nos malheurs, la figure qu’ils proposent à nos espérances, entre les négociations que nous effectuons sans cesse entre Don Quichotte et Sancho en nous, entre nos bouffées délirantes et nos intérêts bien entendus..
Nier une autonomie relative dans l’évolution du corpus idéologique, interdit d’en saisir le rôle d’interface entre un monde qu’il s’agit et d’interpréter et de transformer et un corps de croyants ou de propagateurs.
Ces notions s’appliquent à l’idée de puissance. Il semble assez naturel que tout idéologie sépare une bonne puissance (suivant le cas au service du peuple, de la science, d’une classe, d’une race…) d’une mauvaise, responsable de tous nos désastres. L’idéologie sert à proclamer des guerres justes, des richesses bénéfiques, des dominations légitimes.
III-La force des représentations
« L'influence d'une idéologie ne peut s'analyser en termes idéologiques. Le secret dynamique de l'«action des idées dans l'histoire» est à chercher dans leurs supports et relais de transmission. »[19] Régis Debray
L’idéologie suppose deux sortes de rapports :
1) entre des cerveaux et les systèmes d’idées qu’ils produisent ou reproduisent, et,
2) entre des cerveaux et des cerveaux. Ces derniers sont reliés par des moyens matériels et organisationnels de propagation, par exemple les communautés d’intellectuels et les médias. Il s’agit donc de les examiner comme deux aspects d’une même question.
Robinson sur son île produit des fantasmes, pas une idéologie. Sous la forme d’un lourd traité ou d’un bref slogan, l’idéologie, ce sont des idées (affirmations relatives à l’état du monde) reliées par la cohérence du système ; ce sont aussi des idées qui relient20 ceux qui les adoptent.
Allons plus loin : adopter, c’est adapter. Cette bizarre translation des idées, marchandise qui trouve repreneur de tête en tête n’est pas un mécanisme binaire : je prends/ je ne prends pas, je crois / je ne crois pas, mais un processus de participation. L’idéologie me change : mon point de vue sur le bien et le mal, le nécessaire ou le souhaitable est modifié ; je n’interprète plus le monde suivant les mêmes grilles. Mais je change l’idéologie : comme individu, j’en donne ma version, comme membre d’une communauté nouvelle, je participe à ses évolutions et à ses succès. La « demande » idéologique détermine aussi le marché des idées.
La propagation de l’idéologie suppose des médiateurs et des vecteurs. Dans nos sociétés, cela s’appelle des intellectuels et des médias. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls et ce ne sont pas nécessairement les plus efficaces. L’école, la famille, l’armée, le syndicat, le milieu social – il serait stupide de le nier – transmettent les idéologies, au même titre qu’elles inculturent.
Mais intellectuels et médias ont un rapport plus essentiel avec l’idéologie : leur fonction est de lutter pour occuper l’attention des citoyens et leur raison d’être de leur apprendre à juger le monde. Là où des appareils de transmission plus « lourds », institutions, Église, armée instillent l’ensemble des préjugements que tend à partager une population donnée (la doxa chère aux sciences sociales), les médias et les intellectuels réagissent à l’événement, quitte à le fabriquer et le font entrer dans des cadres explicatifs. À l’instant donné, ils jugent et tranchent, conjuguant l’idéologie au présent continu. Du moins, maintenant et dans nos sociétés. Car il ne faut « essentialiser » ni l’intellectuel ni le média.
L’idée que, par nature, le premier est critique, voire qu’il est un clerc voué au service des valeurs universelles, au détriment de ses intérêts temporels et de ceux de sa communauté,[21] pareille idée est tout simplement fausse. Tout comme l’est la représentation symétrique du « chien de garde », alibi de l’ordre établi. Ni nécessairement fulminant, ni forcément courtisan, l’intellectuel est toujours prescrivant. Il ne se caractérise pas par la production d’idées – justes ou fausses, délirantes ou utiles, généreuses ou hypocrites -, mais par la volonté de les traduire dans la réalité via l’opinion. Il est celui qui veut intervenir sur le cours des choses par la seule publication de son jugement.
De la même façon, il est naïf de réduire les médias au rôle de fourriers de l’idéologie dominante (ceux qui le soutiennent font exception pour le livre, refuge de l’esprit critique et l’opposent volontiers à l’image fascinante). D’abord pareille affirmation est tautologique : si une idée dominante ne dominait pas les médias de masse, que dominerait-elle ? Ensuite parce que c’est plus que simplificateur, même sous la forme de la théorie plus subtile qui fait des médias une langue sans réponse, des moyens d’empêcher de penser, efficaces par leur vacuité même. Les médias amplifient aussi des changements et mettent en valeur des contradictions et des dissidences.
L’idéologie n’est pas préconstituée, ce n’est pas une ressource disponible que les médias ou les intellectuels décident ou pas de diffuser ou de critiquer, soit de par leur libre décision, soit sous la pression d’intérêts, soit enfin sous des contraintes tenant à leur nature même. Elle se forme dans le processus de son énonciation et de sa diffusion. C’est en ce sens que les médias sont l’idéologie.
La critique des médias et celle des intellectuels sont salubres (et que dire de la critique des intellectuels médiatiques !). Mais elle se trompe si elle leur reproche de se « soumettre » à une idéologie. C’est confondre au moins trois niveaux d’analyse.
Le premier touche aux convictions d’individus et l’usage qu’ils font de leur position grâce à leur pouvoir de montrer ou de ne pas montrer. C’est un pouvoir de favoriser telle thèse ou telle grille d’explication. Ils peuvent même militer plus ou moins consciemment pour telle valeur ou telle idée. Ces individus, ce sont des journalistes et les « garde-barrières » qui, dans les rédactions et les directions, décident de ce qui sera imprimable ou montrable. Ce sont des essayistes et des commentateurs, des artistes ou des personnalités, des « gens connus pour être connus »[22] Ils mettent leur capital de sympathie dans le public au service d’une cause, d’une idée ou d’une indignation. Ou, plutôt ils font usage leur capacité de diriger l’attention d’autrui. Nul ne songe non plus à nier la puissance des réseaux et solidarité, ni celle des conformismes de groupe ou de caste. Ni le monde des médias, ni celui des intellectuels, chercheurs ou universitaires n’en sont plus indemnes que celui des cadres supérieurs ou des employés de bureau.
À deux différences près. La première est que, leurs choix, les premiers auront des moyens de les faire partager aux seconds en leur proposant certaines représentations de la réalité. La seconde c’est qu’il existe des stratégies d’influence destinées à exploiter ce pouvoir. Certaines mobilisent l’appareil d’État quand leur but est de propager un « point de vue » favorable aux desseins d’une Puissance.
Un nouveau lieu commun, répétant la critique des « industries culturelles », telle qu’elle fut ébauchée dès les années 40, veut que la culture distractive, avec ses modes de consommation, ses marques et ses styles, soit le facteur d’un conditionnement planétaire. C’est la thèse de la censure silencieuse, de la propagande invisible,[23] du formatage par l’idéologie marchande et euphorisante. Sous une forme plus simple encore, c’est la thèse de l’américanisation de la planète. Comme tous les lieux communs, celui-là véhicule une large part de vérité. Mais il ne rend pas compte des échecs de l’influence, car, suivant la formule, on peut adorer le rock et être un terroriste islamiste. D’autre part, ceci s’inscrit encore dans une vision naïve du « bon usage ». Elle suppose que les médias – et ceci vaut aussi pour les intellectuels -[24] pourraient envoyer de « bons » messages ou prôner de « bonnes valeurs » ou être davantage pluralistes, si seulement… C’est négliger le processus de transmission et sa dimension technique.
Cela renvoie à un second niveau de réalité : celui des contraintes qu’exercent les moyens de diffusion sur les moyens de production des idées, discours et images. Là encore, la plupart des dénonciateurs de « l’idéologie de la communication » tendent à confondre l’insuffisance de la représentation et son orientation. L’incapacité à rendre compte de la complexité du réel ne résulte pas d’un complot. Les lois qui gouvernent ce qui est visible, énonçable, digne d’attention, mémorisable, commercialisable en une époque n’ont rien à voir avec une manipulation. La simplification crétinisante ne doit pas se confondre avec le totalitarisme mou. Pour le croire, il faut n’avoir aucune idée de ce qu’est un conducteur de Journal Télévisé (en parlant des médias, c’est presque toujours à la télévision qu’on songe), de l’hystérie qui règne dans une rédaction, de l’importance du temps, du fonctionnement en boucle des médias qui se surveillent les uns les autres, du rôle de l’image disponible ou non disponible.
Tout ce qu’on reproche aux médias, nous y souscrivons. Sensationnalisme, surexcitation permanente, prédominance de l’émotion sur l’analyse, hystérie de la lisibilité (tout, tout de suite, totalement intelligible), consensualisme, grégarisme, nombrilisme, « idéologie du live, du direct, de l’instantané »,[25] croyance que n’existe que ce qui est visible, perte du sens de la proportion entre ce qui est important, proche, probable et ce dont on parle… Nous ajouterons même volontiers : personnalisation (les causes s’assimilent à des gens sympathiques ou méchants et les idées à des attitudes généreuses et modernes ou pas), urgence et « fast thinking »,[26] mythification de « l’expertise », tendance au propos moralisateur, oubli du principe de non-contradiction, tendance à se poser en juges sans avoir à se justifier, conformisme se réclamant du prestige de l’audace et de la marginalité. Tout cela, oui, tout cela est vrai. Mais n’en déduisons pas que ce sont les effets de la domination invisible des « maîtres du monde ».
De même, nous sommes prêts à souscrire au procès des intellectuels, pourvu ce ne soit pas prétexte à développer une théorie générale de l’Histoire et de la Raison. Énumérons : tendance à garder les mains propres sans avoir de mains (morale de la conviction théâtrale), psittacisme, autisme collectif, « bougisme »,[27] emphase souvent teintée de radical chic, moralisme pathologique de la condamnation sans participation, obsession de l’immédiat, stratégies personnelles.[28] Tout cela peut se rapporter à des causes sociologiques évidentes, notamment la place d’une communauté vouée à la production de jugements dans des sociétés où prédominent la manipulation des signes. Mais cette sociologie-là renvoie indirectement à un technologique. Car le statut de l’intellectuel est lié au fonctionnement médiatique.
Les médias bouleversent la hiérarchie au sein de la République des lettres ; ils donnent l'autorité intellectuelle, la légitimité. Ils confèrent le droit de parler au nom de l'Universel suivant des critères qui ne sont plus ceux du temps de l'écrit. Instaurant des contre hiérarchies, bouleversant les modes de fonctionnement de l’intelligentsia, les médias changent aussi les lois de la production et de la diffusion des idées. La demande de "commentaire" immédiat, le besoins d'idées accordées au tempo de la perception médiatique imposent leur formatage et le rétrécissement de leur "durée de vie". Les circuits par où elles se diffusent désormais, l'effacement de la mémoire au profit de l'immédiat, le filtre de l'écran, tout cela définit quel type de discours peuvent émerger, se répandre et disparaître. Parallèlement, le statut de l'intellectuel change. La néo-intelligentsia a ses rites et ses lois. Les valeurs qu'elle prône, performance, authenticité, dédramatisation, compassion, modernité, reflètent ce même monde qui produit l'intellectuel multimédia et la star. Ils ont même statut et tiennent même discours, ils deviennent interchangeables.
Si l’on s’en tenait à ce rapport, le couple média/intellectuels, tel qu’il apparaît sous nos latitudes ces dernières années semble tendanciellement défavorable à la puissance (question qu’il faut séparer de celle du Pouvoir, au sens de consensus à l’ordre établi, …) Ce binôme médias/intellectuels paraît mal adapté à la propagation d’idées ou de représentations exaltant la puissance collective. Il est tout plutôt favorable au mondial qu’au local. Il se réfère aux principes du Droit et de la Morale (humanitaire, droits de l’homme, tolérance, différence) contre les appels au réalisme ou à la nécessité de la force. Il est plutôt orienté vers la communication, l’influence et la négociation, domaines où il excelle, donc plutôt optimiste. Sa tendance naturelle est de croire que nous allons vers plus de modernité, d’harmonie. Par ses habitudes, il est réticent à tout ce qui est brutal ou emphatique. Il se complaît à s’indigner. Il plaint les victimes plus volontiers qu’il ne justifie les disciplines ou les souffrances nécessaires. La morale de la responsabilité lui est étrangère. Bref, le monde des médias et de l’intelligentsia, semble rétif au tragique de l’histoire et plus enclin à désigner le Mal au nom de principes qu’à se colleter aux contradictions du réel.
L’explication suppose sans doute un troisième point de vue. Il replacerait les conceptions et les contraintes propres aux moyens de transmission, dans l’environnement plus large où ils prospèrent : cultures et systèmes de répartition du pouvoir. Ni les points de vue des acteurs, ni les logiques des techniques et des organisations n’échappent à ce milieu qui les englobe, à cet environnement invisible déjà évoqué.
Ici l’actualité impose une comparaison entre la France et les U.S.A. Notre vanité nous fait facilement présenter comme un peuple féru d’idées et grands principes comme il l’aurait démontré depuis les Lumières. Nous serions sensibles aux passions intellectuelles ce qui contrasterait avec le pragmatisme anglo-saxon. Nous serions une Nation où les sociétés de pensée, les réseaux intellectuels, la République des Lettres en général et les gazettes pensantes en particulier pèsent un poids exceptionnel.
À cette vision, il faudrait, avec plus de réalisme, opposer celle d’une Amérique où « les idées comptent »[29] où la référence aux principes est constante, et où la production de concepts est envisagée comme une stratégie de puissance ou de prise de pouvoir.
À cela, il y a beaucoup d’explications. La tradition du « social scientist » et du « problem solving », la tendance à penser le monde en termes de problème et solution y tiennent leur part. Le système politique y a la sienne : se tourne facilement vers l’expert pour trouver la réponse neutre, calculée en coûts et avantages et qui entraînera le consensus. Les considérations économiques n’en sont pas absentes non plus. Investir dans des centres de recherche qui promeuvent les valeurs auxquelles vous croyez ou qui défendent les intérêts dont vous dépendez, est aussi naturel outre-Atlantique que de donner à des fondations charitables. Ce peut être aussi intéressant fiscalement. Les limites du lobbying et du militantisme, de l’investissement et de la catéchèse ne sont pas si nettes. Enfin, il faudrait analyser la formidable efficacité des think tanks, aussi habiles à promouvoir des carrières individuelles des intellectuels amis, qu’à occuper les tribunes médiatiques, aussi capables de proposer des solutions pour orienter le politique que d’anticiper les tendances et « faire » le débat. Elles savent passer instantanément de la proposition à la conceptualisation et vice versa. Pour revenir à l’exemple des néo-conservateurs, cela comment une poignée d’intellectuels a fini par peser d’un tel poids sur les affaires du monde.
Conclusion
Le siècle précédent semblait avoir mené à leur paroxysme la logique des idéologies incarnées sur un territoire et en un Pouvoir, nazisme et communisme. C’était le projet de transparence de la Société, réduite à un principe unique et à une loi unique (race et nature dans un cas, sens de l’Histoire et matérialisme dialectique dans l’autre). Après la chute des deux grands totalitarismes, ce ne sont pas les « ismes » qui ont manqué : libéralisme, écologisme, européisme, catastrophisme, souverainisme, droitdelhomisme, mondialisme et altermondialisme, modernisme, technologique et communicationnel. Mais dans tous ces systèmes, le politique n’avait plus le même statut. La volonté de transformer le réel se transformait soit en respect de lois incontrôlables (le progrès, le marché, l’évolution de la technique) soit en contestation de pseudo-lois de la fatalité au nom d’une loi supérieure telle la Nature, le droit des peuples, la nécessité du politique. Dans tous les cas, le monde est pensé en termes de périls et limites. D’une certaine façon c’étaient des idéologies de l’adaptation. Or revoici des idéologies de la volonté. Elles aussi se réclament d’une autre loi, Dieu, ou le Léviathan planétaire, mais leur ambition est sans borne.
Un attentat et la guerre qui l’a suivi ont ouvert une autre dimension : jamais les idées professés par une poignée d’homme n’avaient changé aussi rapidement le cours des choses, les premiers détournant des avions, les seconds des institutions. Si l’ère de l’hyperpuissance était celle de l’hyperidéologie ? Si le vrai « siècle des idéologies » n’était pas derrière, mais devant nous ? C’est ce que suggèrent ces deux « luttes finales », l’Oumma contre les impies ou la démocratie contre la Terreur. La volonté de transformer la Planète, que ce soit pour y instaurer la loi divine ou l’Empire du Bien, implique le principe d’une Puissance absolue et d’une politique absolue. Certes, tout pronostic est incertain : demain s’il se trouve une autre voie pour exprimer la frustration des masses islamiques ou si les USA réorientaient leur politique étrangère, les prédictions apocalyptiques pourraient être démenties. Et l’on oublierait – mais nous n’y croyons guère – de telles chimères Dans tous les cas, nous savons qu’il nous faudra vivre dans l’impératif de la grande politique.
Avec peut-être la perspective que nous indique Peter Sloterdjik d’une « translation de l’Empire », si ce n’est dans l’espérance que l’Europe devienne «le séminaire où les gens apprennent à réfléchir au-delà de l’Empire ».[30]
François-Bernard Huyghe
[1] Nous maintenons la définition que nous avions donnée dans les Cahiers de Médiologie n° 6 (http://www.mediologie.org) : Idéologies : Définition banale de l’idéologie : fumées (idées de l’autre), utopies, délires, rêverie, idées contre réalité… Définition chic : représentation du monde apparemment rationnelle (mais partielle et faussée) que se font des acteurs en fonction de leur position et de leurs intérêts (notion qui permet d’expliquer pourquoi l’idéologie dominante, o surprise, domine les médias). Rappel : “une” idéologie, ça n’existe pas. Mais il y a des idéologies, des systèmes d’idées polémiques traduisant des évaluations et passions et visant à des effets concrets ; ils se heurtent à d’autres systèmes et tendent à se propager dans d’autres têtes…
[2] K. Jaspers, Origine et sens de l’histoire, Plon 1954
[3] Peter Katzenstien The culture of National Security Norms and Identigy in world politics, Columbia U. Press 1996, et Martha Finnemore, The Purpose of Intervention, Cornell U. Press, 2003
[4] Robert Kagan, La puissance et la faiblesse, Plon Commentaire, 2003
[5] Robert Kagan, Le revers de la puissance, Plon 2004
[6] Nous avons nous même consacré un chapitre au rôle de l’idéologie dans la guerre dans Quatrième guerre mondiale Faire mourir et faire croire. Ed. du Rocher, 2004
[7] Pascal Bruckner, La mélancolie démocratique, Seuil, 1990
[8] Philippe Breton et Serge Proulx, L’Explosion de la Communication (la naissance d’une nouvelle idéologie), Montréal, La Découverte / Boréal, 1989
[9] Alain Birnbaum, La fin des idéologies, Payot, 1976
[10] Alain Birnbaum, La fin des idéologies, Payot, 1976
[11] Le thème de la quatrième guerre mondiale contre l’islamisme ou le terrorisme (la troisième étant censée être la guerre froide) se retrouve chez nombre de néo-conservateurs comme Norman Podhoretz ou Richard Woolsey. Mais « War on Terror » était le titre d’une rubrique ouverte par CNN après le 11 Septembre.
[12] Edwards Lee, The Power of Ideas, Ottawa, Jameson Books, 1997.
[13] Hannah Arendt, Le système totalitaire, Seuil 1972, p 219 où elle définit très justement l’idéologie comme un « sixième sens » pour percevoir la réalité.
[14] Voisin de Destutt de Tracy, Éléments d’idéologie, 1801
[15] Lettre d’Engels à F. Mehring, 14 juillet 1893, in K. Marx et F. Engels, Études Philosophiques http://www.huyghe.fr
[16] Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1954
[17] Alain Besançon, Présent soviétique et passé russe, Pluriel, 1980
[18] Edgar Morin, Pour sortir du XX° siècle, Nathan, 1984
[19] Régis Debray, Debord de loin, Le Débat n° 85, Mai-Août 1995
[20] Écho d’un vieux débat qui préoccupait déjà Cicéron : la religion vient-elle de religere (relier des éléments du dogme comme on relie un volume) ou de religare : relier une communauté de croyants. La question s’applique encore mieux à l’idéologie.
[21] C’est la fameuse thèse de Julien Benda, la trahison des clercs.
[22] Daniel Boorstin, L’image, 10/18, 1966.
[23] Ignacio Ramonet, La tyrannie de la communication, Gallilée 1999 et Propagandes silencieuses, Galilée 2000.
[24] Pierre Bourdieu , Sur la télévision, Liber, 1997.
[25] Ignacio Ramonet, précité p. 28.
[26] Bourdieu Sur la télévision précité.
[27] L’expression est de Pierre-André Taguieff, Du Progrès, Librio, 2001.
[28] Sur ce point, nous renvoyons à la suite de Régis Debray : Le scribe (Grasset 1985) et Le pouvoir intellectuel en France, (Ramsay 1986), puis L’emprise et I.T. (Gallimard le Débat, 2001 et 2002).
[29] Un slogan d’Heritage, importante think tank conservatrice.
[30] Peter Sloterdjik, Si l’Europe s’éveille, Fayard 2003
Bibliographie :
Sur la notion d’idéologie
Althusser Louis, Pour Marx, Paris, Maspero, 1966.
Arendt Hannah, The Origins of Totalitarism 1951 trad. Le Système totalitaire Paris Seuil 1972 Aron Raymond, L’opium des intellectuels, Paris, Calmann-Lévy 1955.
Baechler J. , Qu’est-ce que l’idéologie ? Gallimard, 1976.
Benda Julien, La trahison des clercs Paris, Gallimard, 1927.
Bouricaud François, Le bricolage idéologique, Paris, P.U.F. 1981.
Châtelet François, Histoire des idéologies, 3 volumes, Paris, Hachette 1978.
Gramsci Antonio, Essais politiques I, 1914-1920, Paris, Gallimard.
Dumont François, Les idéologies, Paris, P.U.F., 1974.
Mannheim Karl, Ideologie und Utopie, 1929, Idéologie et utopie, Paris, 1956. Reboul Olivier, Langage et idéologie, Paris P.U.F. 1980.
Ricoeur Paul, L’idéologie et l’utopie, Seuil 1997.
Sur l’histoire récente des idéologies
Boltanski Luc et Chiapello Eve, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.
Breton P. L'utopie de la communication, Paris La Découverte, 1992.
Castoriadis Cornélius, La montée de l’insignifiance, Carrefours du labyrinthe IV, Paris, Seuil, 1996.
Challiand Gérard et Blin Arnaud, America is back Les nouveaux Césars du Pentagone, Paris,Bayard, 2003.
Conquest Robert, Le féroce XX° siècle. Réflexions sur les ravages des idéologies. Syrtes 2001.
Debord G., La société du spectacle, Buchet Chastel, 1967.
Faye Jean-Pierre, Le siècle des idéologies, Armand Colin, 1990.
Hassner Pierre et Vaïsse Juston, Washington et le monde, Paris Ceri/Autrement, 2003.
Lasch Christopher, La révolte des élites, Climats, 1996.
Le Goff Jean-Pierre, La démocratie post-totalitaire, Paris, La Découverte, 2003.
Lévy Pierre, Cyberculture, Odile Jacob, 1998.
Lipovetsky Gilles, L’ère du vide, Paris, Gallimard, 1983.
Marcuse Herbert L'homme unidimensionnel, Ed. de Minuit, 1968. Mattelart A., Histoire de l’utopie planétaire de la cité prophétique à la société globale, Paris La Découverte, Textes à l’appui, 1999.
Ricci David M., The transformation of American Politics, The New Washington and the Rise of Think Tanks, New Haven, Yale University.