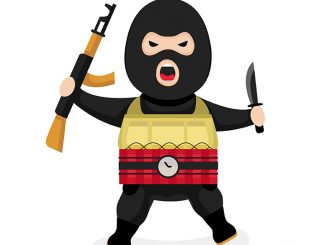Le documentaire de Pierre-Olivier François et Jean-Marc Dreyfus, diffusé sur Arte le 10 juin, offre une perspective fouillée et glaçante sur un aspect spécifique mais central de l’Occupation : la collaboration d’État, incarnée par deux figures aussi complémentaires qu’essentielles, le Français Fernand de Brinon et l’Allemand Otto Abetz. Loin de se contenter de survoler la période, le film dissèque la mécanique de leur action, leurs motivations idéologiques et personnelles, ainsi que les conséquences funestes de leur entente. Un documentaire essentiel qui, en se concentrant sur deux trajectoires, offre une mise en garde puissante. A partir d’images d’archives et de témoignages inédits, il montre comment des ambitions personnelles, des convictions idéologiques et un même aveuglement politique ont pu transformer des hommes en instruments d’un régime totalitaire, le régime nazi, les rendant complices des pires atrocités.
Paris, le 16 juin 2025 — European-Security
Sommaire
Au cœur de la collaboration franco-allemande durant la Seconde Guerre mondiale à Paris, deux figures se distinguent par leurs fonctions officielles et leur engagement idéologique : Otto Abetz, ambassadeur du Reich, et Fernand de Brinon, délégué général du gouvernement de Vichy auprès des autorités d’occupation. Leur action conjointe a incarné la collaboration d’État, visant à intégrer la France dans une Europe nouvelle sous l’égide du Troisième Reich.
Ces deux hommes ont joué un rôle de premier ordre dans la collaboration entre la France occupée et le Reich allemand. Fernand de Brinon était en quelque sorte l’ambassadeur de France du gouvernement de Vichy auprès des forces de l’occupation allemande. Il était à la fois l’ami et le rival d’Otto Abetz, ambassadeur du IIIe Reich à Paris. Une de leurs proche, Josée de Chambrun, la fille de Pierre Laval, a méticuleusement consigné leur traversée des années de guerre dans les fastes de la diplomatie, entre pillage des richesses nationales et chasse aux Juifs et aux résistants. C’est à partir de ces documents notamment que Jean-Marc Dreyfus et Pierre-Olivier François ont réalisé ce film-documentaire de qualité, sur un sujet rarement traité en France.
Fernand de Brinon
Aristocrate et journaliste, Fernand de Brinon (1885-1947), était un partisan de longue date d’un rapprochement avec l’Allemagne. Dès les années 1930, il milite pour une entente avec le régime nazi. Après la défaite de 1940, il devient l’une des figures de proue de la collaboration.
Avant la guerre : pionnier du rapprochement avec l’Allemagne nazie
Dès 1933, le journaliste Fernand de Brinon se distingue en étant le premier Français à obtenir une interview exclusive d’Adolf Hitler. Une rencontre qui marque le début d’une longue relation avec les hauts dignitaires du régime nazi. Convaincu de la nécessité d’une entente franco-allemande, même sous l’égide nazie, il multipliera les contacts avec le nouveau pouvoir allemand.
En 1935, il concrétise son engagement en créant le Comité France-Allemagne. Une organisation, qu’il anime activement, qui a pour objectif la promotion de liens plus étroits entre les deux pays, mais aussi de faciliter les rencontres entre les élites françaises et les responsables nazis, contribuant ainsi à la propagande du Troisième Reich en France. Brinon deviendra en 1940 un interlocuteur privilégié des Allemands à Paris, entretenant des relations suivies avec des figures de premier plan, comme Otto Abetz, le futur ambassadeur du Reich à Paris. Entre 1935 et 1937, il rencontrera Hitler à cinq autres reprises.
Pendant l’occupation : Ambassadeur de la collaboration
Avec la défaite de 1940 et l’instauration du régime de Vichy, les liens de Brinon avec le nazisme prennent une dimension officielle. En novembre 1940, il est nommé délégué général du gouvernement français dans les territoires occupés, un poste équivalent à celui d’ambassadeur de Vichy à Paris auprès des autorités allemandes. À ce titre, il devient l’un des artisans majeurs de la collaboration d’État. Ses actions et ses relations témoignent de son allégeance à la politique nazie :
- Collaboration étroite avec Otto Abetz : Il travaille main dans la main avec l’ambassadeur allemand. Ensemble, ils animent la vie politique et mondaine de la collaboration à Paris, partageant la vision d’une Europe fasciste sous domination allemande.
- Soutien à l’effort de guerre allemand : Il soutient activement des initiatives comme la création de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme (LVF), destinée à envoyer des Français combattre aux côtés de la Wehrmacht sur le front de l’Est.
- Adhésion aux manifestations de propagande nazie : Une photographie tristement célèbre le montre effectuant le salut nazi devant le tombeau de l’Aiglon lors du transfert de ses cendres aux Invalides en décembre 1940, une cérémonie orchestrée par les Allemands.
Jusqu’à la fin de la guerre, Fernand de Brinon restera un des piliers du collaborationnisme français. En 1944, après le Débarquement, il dirigera même la Commission gouvernementale de Sigmaringen, une tentative de maintenir un gouvernement français en exil en Allemagne.
Après la Libération, son engagement sans faille aux côtés de l’Allemagne nazie lui vaudra d’être jugé par la Haute Cour de justice et d’être condamné à mort pour intelligence avec l’ennemi. Il sera exécuté en avril 1947.
Otto Abetz, l’ambassadeur du Reich à Paris
Otto Abetz (1903-1958) est nommé ambassadeur d’Allemagne à Paris en août 1940, peu après l’armistice. Ancien professeur de dessin et francophile dans sa jeunesse, il avait été actif dans les cercles de rapprochement franco-allemand dans l’entre-deux-guerres. Cependant, son parcours le mène à adhérer au parti nazi et à devenir un rouage essentiel de la diplomatie hitlérienne.

À Paris, son rôle est ambigu. Il est chargé de mettre en œuvre la politique de collaboration, de superviser la vie politique et culturelle française et de piller les œuvres d’art. Il maintient des relations étroites avec le maréchal Pétain et Pierre Laval, tout en animant une vie mondaine et culturelle intense dans la capitale occupée, invitant dans son ambassade de la rue de Lille de nombreux artistes et intellectuels français. Son objectif est de promouvoir l’idée d’une « nouvelle Europe » fasciste et de s’assurer du soutien des élites françaises au projet allemand.
Il est également impliqué dans la politique antisémite, son ambassade jouant un rôle dans la spoliation des biens juifs.
1. Le Postulat de Départ : Deux hommes, une idée fixe
Le documentaire « Les ambassadeurs de la collaboration » prend soin de présenter ses protagonistes bien avant que la guerre ne les place au sommet de l’appareil collaborateur.
- Otto Abetz : Le francophile perverti. Le parcours d’Abetz est celui d’un germanique passionné par la culture française. Dans les années 1930, il anime des cercles de jeunesse franco-allemands, rêvant d’une réconciliation entre les deux nations. Une francophilie progressivement instrumentalisée et pervertie par l’idéologie nazie. Séduit par le national-socialisme, Abetz s’est très tôt rapproché de Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich. Sa connaissance intime des réseaux politiques, artistiques et intellectuels français est alors considérée comme un atout majeur pour l’Allemagne. Le film le dépeint comme un homme qui a utilisé son amour pour la France pour mieux l’asservir.
- Fernand de Brinon : L’ambition d’un germanophile. Journaliste et aristocrate, Fernand de Brinon est présenté comme un homme ambitieux, persuadé que l’avenir de la France passe par une entente durable avec l’Allemagne, quelle que soit la nature de son régime. Son fait d’armes est d’avoir été le premier journaliste français à obtenir, dès 1933, une interview d’Adolf Hitler. Cet événement le propulse comme un interlocuteur privilégié et un « spécialiste » autoproclamé des relations franco-allemandes. Le documentaire montre comment son désir de jouer un rôle de premier plan et sa conviction idéologique l’ont aveuglé, le menant à devenir l’un des piliers de la collaboration.
2. Les Architectes de la Collaboration (1940-1944)
Une fois la France vaincue et occupée, Otto Abetz est nommé ambassadeur à Paris et Fernand Brinon devient le délégué général du gouvernement de Vichy dans la zone occupée. Ils forment alors un duo redoutablement efficace.
- La collaboration politique et diplomatique : Le film détaille comment les deux hommes ont été l’interface permanente entre Vichy et Berlin. Ils facilitent les rencontres, dont la tristement célèbre entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler. Leur objectif commun est d’ancrer durablement la France dans une « Europe nouvelle » sous hégémonie nazie. Ils œuvrent à aligner la politique française sur les desiderata allemands, poussant le gouvernement de Vichy toujours plus loin dans la compromission.
- La collaboration culturelle et mondaine : L’un des aspects les plus fascinants et troublants mis en lumière par le documentaire de est la vie mondaine et culturelle qu’ils animent dans le Paris occupé. Abetz, en particulier, organise des réceptions fastueuses à l’ambassade d’Allemagne, où se presse le « tout-Paris » des arts, du spectacle et de la presse (tels que Sacha Guitry, Arletty ou Coco Chanel). Cette intense activité de propagande vise à donner l’image d’une « normalisation » et d’une coopération intellectuelle fructueuse. Le film oppose crûment l’éclat de ces soirées au champagne à la misère, aux rafles et à la terreur qui règnent dans les rues de la même ville.
- L’implication dans la persécution et le pillage : Le documentaire de Jean-Marc Dreyfus et de Pierre-Olivier François ne se limite pas à la diplomatie et aux mondanités. Il démontre la responsabilité directe des deux hommes dans les aspects les plus sombres de l’Occupation. Ils sont les rouages essentiels dans la mise en œuvre de la politique antisémite, facilitant la spoliation des biens juifs et coopérant activement à la logistique des déportations. Leur action n’est pas passive ; elle est une complicité active dans les crimes contre l’humanité commis par le régime nazi.
3. La Chute : Sigmaringen et le Jugement de l’Histoire
Avec l’avancée des Alliés en 1944, le rêve d’une Europe nazie s’effondre.
- L’ultime refuge : Brinon et une partie du gouvernement de Vichy suivent leurs « protecteurs » allemands dans leur retraite jusqu’au château de Sigmaringen, en Allemagne. Le documentaire dépeint cette période comme une « fin de règne » pathétique, une ultime mascarade où ce gouvernement en exil prétend encore diriger la France.
- L’heure des comptes : Après la guerre, ni Brinon ni Abetz n’échappent à la justice. Fernand de Brinon est jugé en France, condamné à mort pour haute trahison et exécuté en 1947. Otto Abetz est également jugé par un tribunal français et condamné aux travaux forcés ; il sera finalement libéré en 1954 et mourra dans un accident de voiture quelques années plus tard.
En conclusion, « Les Ambassadeurs de la Collaboration » est un documentaire essentiel qui, en se concentrant sur ces deux trajectoires, offre une mise en garde puissante. Il illustre comment des ambitions personnelles, des convictions idéologiques et un aveuglement politique peuvent transformer des hommes en instruments d’un régime totalitaire, les rendant complices des pires atrocités. C’est une analyse précise de la responsabilité individuelle au cœur de la collaboration d’État.
Réflexion pour Analyse par Jean-Marc Dreyfus et Pierre-Olivier François
Idéologie ou Opportunisme ?
- Qu’est-ce qui a principalement motivé ces hommes ? Le documentaire suggère un mélange toxique : une conviction idéologique réelle (anticommunisme, vision d’un ordre nouveau) qui sert de justification morale à une ambition personnelle démesurée. L’opportunisme leur a permis de gravir les échelons, et l’idéologie de rationaliser leurs pires actions.
- La Culture comme arme de propagande : Analyser comment la collaboration « mondaine » a servi de vitrine pour masquer la brutalité de l’Occupation, une forme de « soft power » avant l’heure. Comment des artistes ont-ils pu se compromettre ?
- Était-ce par naïveté, par cynisme, par vanité, par antisémitisme, ou par simple nécessité de continuer à travailler ? La question reste complexe et douloureuse.
- La Responsabilité Individuelle : Le cas de Brinon et Abetz pose la question de la « banalité du mal » théorisée par Hannah Arendt. Ce ne sont pas des monstres incultes, mais des hommes éduqués et raffinés qui sont devenus des acteurs zélés d’un système criminel. Leur histoire démontre que la culture ne vaccine pas contre la barbarie et pose la question de la responsabilité personnelle face aux ordres et à l’idéologie dominante.
- Un avertissement pour aujourd’hui : En quoi l’étude de ces mécanismes de collaboration peut-elle éclairer notre époque ? En nous alertant sur les dangers de la polarisation politique, la séduction des discours autoritaires qui promettent un retour à l’ordre, et l’érosion lente des normes démocratiques lorsque des élites choisissent la compromission par peur ou par intérêt. C’est une leçon sur la fragilité des démocraties face aux menaces internes et externes.