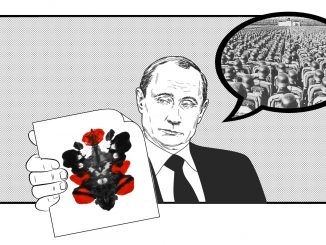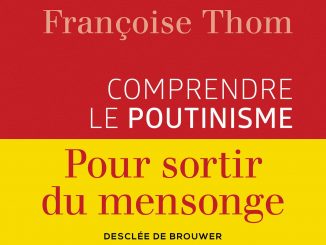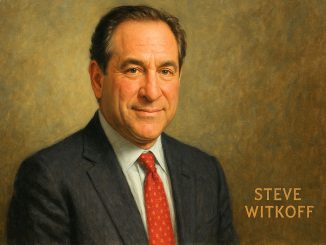La visite d’État du président américain Donald Trump au Royaume-Uni du 16 au 18 septembre 2025, bien que marquée par le faste d’une réception royale orchestrée par le roi Charles III, s’est conclue par un séisme diplomatique pour les alliés européens. Accueilli à Londres, avec tous les honneurs par le Roi Charles III, cette visite était perçue comme une opportunité d’influencer la politique américaine envers l’Ukraine.
Malgré le faste royal et les efforts diplomatiques britanniques déployés par la Grande-Bretagne, Trump a maintenu ses positions ambiguës sur le conflit ukrainien, se déclarant simplement déçu par Vladimir Poutine sans annoncer de mesures concrètes. Pour la première fois, il a implicitement reconnu que ses premières déclarations étaient prétentieuses, mais cette évidence n’a pas débouché sur des changements politiques substantiels.

Au contraire, Trump a confirmé la réduction de l’aide américaine aux pays d’Europe centrale et orientale directement menacés par la Russie. La presse britannique et américaine, ainsi que les instituts spécialisés, ont unanimement souligné l’échec de cette tentative d’influence diplomatique. Le Times a qualifié cette stratégie de « mouvement risqué », tandis que la BBC a mis en évidence le « fossé croissant entre les États-Unis et l’Ukraine ».
Les analystes de Chatham House et du Council on Foreign Relations ont confirmé que Trump restait « imperméable aux pressions diplomatiques traditionnelles ». Cette séquence illustre parfaitement les limites du soft power européen face à une administration qui privilégie les rapports de force directs aux subtilités diplomatiques, contraignant l’Europe à repenser ses stratégies d’influence et à envisager une plus grande autonomie stratégique.
Loin du geste d’apaisement espéré sur le dossier ukrainien, le président a confirmé sa doctrine transactionnelle en matière de sécurité collective. La visite a été immédiatement suivie de l’annonce d’une « réévaluation stratégique » de l’aide sécuritaire américaine à l’Europe, largement interprétée comme un désengagement partiel.
Cette décision, couplée à une rhétorique ambivalente envers le président russe Vladimir Poutine, a provoqué des réactions profondes, allant de la consternation à la colère, au sein de la presse et des instituts spécialisés britanniques et américains.
Revue de presse de Joël-François Dumont — Paris, le 19 septembre 2025 —
Sommaire
1. La presse britannique : Le Pomp & Circumstance face à la brutalité stratégique
Les médias britanniques, toutes orientations confondues, ont souligné le contraste saisissant entre la splendeur de l’accueil royal et la froideur des résultats politiques. L’analyse générale est celle d’un échec de la diplomatie britannique, qui a misé sur le prestige de la monarchie pour amadouer un président imperméable aux charmes de la tradition.
La presse britannique a adopté un ton majoritairement critique envers les résultats de la visite d’État. The Times, dans son analyse post-visite, a qualifié la stratégie de Trump de « mouvement risqué », notant que le président américain « n’est pas prêt à perdre la face » malgré les pressions diplomatiques. Cette analyse met en lumière l’échec relatif de la diplomatie britannique à influencer substantiellement la position américaine.
Le Financial Times a souligné l’ironie de la situation : alors que Trump était reçu avec tous les honneurs royaux, ses décisions politiques concrètes allaient à l’encontre des intérêts européens fondamentaux. Cette dichotomie entre le protocole diplomatique et les résultats politiques tangibles illustre les limites du soft power traditionnel face à une administration américaine peu sensible aux conventions diplomatiques classiques.
La BBC, dans son analyse détaillée, a mis l’accent sur le « fossé croissant entre les États-Unis et l’Ukraine », suggérant que la visite royale n’avait pas réussi à combler ce fossé grandissant. Cette conclusion pessimiste reflète le sentiment général de la presse britannique face à l’échec de cette initiative diplomatique de haut niveau.
La presse de centre-gauche : « La fin de l’illusion »
The Guardian a qualifié la visite de « leçon brutale pour un Royaume-Uni post-Brexit en quête d’influence ».[01] Selon le quotidien, le gouvernement du Premier ministre Keir Starmer a commis une erreur fondamentale en croyant que le faste pouvait se substituer à un rapport de force.
Un éditorialiste écrivait : « Nous avons offert des carrosses et des banquets pour recevoir en retour un ultimatum. Le président Trump n’est pas venu célébrer une alliance, mais présenter une facture pour sa protection ».[02] Le journal a particulièrement insisté sur la concession sémantique de M. Trump, qui a admis implicitement le caractère excessif de ses menaces passées de quitter l’OTAN, la présentant non pas comme une erreur, mais comme une « tactique de négociation initiale nécessaire » pour forcer les Européens à payer. Pour The Guardian, c’est la preuve que « la relation spéciale n’est plus qu’une transaction à sens unique ».[01]
The Independent a abondé dans le même sens, titrant : « Humiliés par notre Ami : Trump repart avec tout, ne laisse que des factures ».[03] L’analyse a mis en lumière la position intenable du Royaume-Uni, qui a obtenu des promesses d’investissement technologique en échange d’un silence assourdissant sur le démantèlement de la sécurité continentale.
La presse conservatrice : La « relation spéciale » en ruine
Pour des journaux plus conservateurs comme The Times et The Daily Telegraph, la critique a porté sur la faillite stratégique et l’humiliation nationale. The Times a noté dans son éditorial principal que « la sécurité de la Grande-Bretagne ne commence pas à Douvres, mais sur le flanc est de l’OTAN. En signalant que l’aide à la Pologne et aux États baltes n’est plus garantie, le président Trump a directement menacé les intérêts vitaux de notre nation ».[04]
Un commentateur du Telegraph a été encore plus direct : « Le roi Charles a rempli son devoir constitutionnel avec une grâce impeccable. Le Premier ministre, lui, a échoué dans son devoir stratégique. Il a accueilli un président qui, à peine reparti, a mis une cible dans le dos de nos alliés les plus vulnérables ».[05] La déception exprimée par M. Trump envers Poutine, qualifiée de « théâtre pour les caméras », a été jugée totalement insuffisante. La phrase de M. Trump lors de la conférence de presse, affirmant que Poutine l’avait « vraiment laissé tomber », a été analysée comme une façon de se dédouaner personnellement sans engager la moindre action concrète contre le Kremlin.[06]
2. La presse américaine : La fracture idéologique exposée
Aux États-Unis, la lecture de la visite et de ses conséquences a suivi des lignes de faille strictement partisanes, reflétant la profonde division du pays sur le rôle de l’Amérique dans le monde.
Les médias traditionnels : Un abandon stratégique
The New York Times a consacré un long article d’analyse à ce qu’il a appelé « la doctrine du désengagement calculé ».[07] Le journal a expliqué que la décision de réduire l’aide n’était pas un coup de tête, mais l’aboutissement d’une vision du monde où les alliances sont vues comme des passifs financiers. « En utilisant le décor de Windsor pour annoncer de facto la fin de l’aide sécuritaire telle que nous la connaissons, le président Trump a offert un cadeau inestimable à Vladimir Poutine et à Xi Jinping, leur montrant qu’ils peuvent compter sur la lassitude américaine », pouvait-on lire.[07]
The Washington Post a mis en garde contre les conséquences à long terme : « L’administration justifie cette mesure par le « partage du fardeau« . En réalité, elle crée un vide de sécurité que ni l’Allemagne, ni la France, ni le Royaume-Uni ne peuvent combler à court terme. « C’est une invitation ouverte à l’agression ».[08] La chaîne CNN a multiplié les interviews d’anciens diplomates et généraux, qui ont unanimement condamné une décision « myope » et « dangereusement déstabilisatrice ».[09]
Les médias conservateurs : Une victoire de l’« Amérique d’abord »
À l’inverse, la visite a été dépeinte comme un immense succès sur Fox News et dans les pages opinion du Wall Street Journal. La manœuvre a été présentée comme une brillante application du principe « Paix par la Force » (Peace through Strength), où la force consiste à obliger les alliés à assumer leurs propres responsabilités.

Un éditorialiste du Wall Street Journal a soutenu que « le président Trump a enfin mis fin à des décennies de politique étrangère où l’Europe externalisait sa défense au contribuable américain. En liant la sécurité à la performance économique et militaire de chaque allié, il ne détruit pas l’OTAN, il la sauve de sa propre complaisance ».[10] Fox News a présenté la réévaluation de l’aide comme une promesse de campagne tenue. Un animateur vedette a déclaré : « Nos frontières sont plus importantes que celles de l’Ukraine. Le président a été clair : nous ne signerons plus de chèques en blanc à des pays qui refusent de payer leur juste part. C’est ce que les Américains ont voté ».[11] La critique de Poutine par Trump a été interprétée comme le signe d’un dirigeant fort qui n’hésite pas à réprimander publiquement même ceux avec qui il entretient des relations complexes.
3. Les instituts spécialisés : L’analyse d’un ordre mondial en mutation
Les think tanks ont rapidement publié des analyses approfondies, soulignant les implications structurelles des décisions annoncées après la visite.
Les instituts de politique étrangère britanniques et américains ont exprimé des analyses convergentes sur l’échec de cette tentative d’influence diplomatique. Le Royal Institute of International Affairs (Chatham House) a souligné dans ses analyses que Trump reste « imperméable aux pressions diplomatiques traditionnelles », confirmant que même le prestige royal britannique ne suffit pas à modifier ses positions géopolitiques fondamentales.
Les analystes américains du Council on Foreign Relations ont noté que la visite, malgré son succès protocolaire, n’avait produit aucun changement substantiel dans la politique étrangère américaine. Cette conclusion rejoint celle de nombreux observateurs qui estiment que Trump privilégie ses relations personnelles avec les dirigeants autoritaires au détriment des alliances traditionnelles occidentales.
Au Royaume-Uni et en Europe : Un signal d’alarme existentiel
Le think tank londonien Chatham House a publié une note d’analyse intitulée « L’Alliance Transactionnelle : Après la visite de Trump, l’Europe est seule ».[12] Le rapport concluait : « La pageantry royale n’a pas réussi à masquer la réalité : la garantie de sécurité américaine est désormais conditionnelle et révocable. Pour les États du flanc Est, c’est une menace existentielle qui les obligera à des choix stratégiques drastiques, allant d’une remilitarisation accélérée à une possible recherche d’accommodements avec la Russie ».[12][13]
L’European Council on Foreign Relations (ECFR) a souligné que cette décision allait accélérer la fragmentation de l’Europe. « Nous allons probablement assister à une division entre une « Europe de la puissance », menée par la France, qui plaidera pour une autonomie stratégique immédiate, et une « Europe atlantiste », menée par la Pologne et les pays baltes, qui tentera par tous les moyens de préserver des liens de sécurité bilatéraux avec Washington, quitte à faire d’importantes concessions commerciales ».[14]
Aux États-Unis : La fin du consensus bipartisan
L’Atlantic Council, traditionnellement un bastion de l’atlantisme, a exprimé sa profonde inquiétude. L’un de ses experts a écrit : « Nous assistons au démantèlement volontaire du plus grand atout stratégique de l’Amérique : son réseau d’alliances. En traitant l’OTAN comme un cartel de protection, l’administration invite nos adversaires à tester notre résolution, avec un risque élevé d’erreur de calcul et de conflit ».[15]
Le Center for Strategic and International Studies (CSIS) a produit une analyse chiffrée des conséquences militaires. « Le retrait du soutien américain en matière de renseignement, de logistique et de capacités de frappe de précision crée un déficit capacitaire sur le flanc Est que les budgets de défense européens, même en augmentation, ne pourront pas combler avant une décennie. Cette fenêtre de vulnérabilité est une aubaine pour le Kremlin ».[16]
Conclusion : L’échec du soft power européen
En définitive, la seconde visite d’État de Donald Trump au Royaume-Uni a été le théâtre d’une clarification brutale. L’espoir des Européens, et notamment des Britanniques, de pouvoir contenir ou influencer la doctrine « America First » par la diplomatie traditionnelle et le prestige s’est fracassé sur la réalité d’une politique étrangère américaine fondamentalement révisée. Pour la plupart des observateurs des deux côtés de l’Atlantique, cette visite ne symbolise pas le renforcement d’une « relation spéciale », mais plutôt le début d’une nouvelle ère anxiogène où la sécurité européenne doit être entièrement repensée, sans la certitude du soutien américain qui la sous-tendait depuis près de 80 ans.
Cette visite d’État au Royaume-Uni illustre parfaitement les limites du soft power européen face à une administration américaine qui privilégie les rapports de force directs aux subtilités diplomatiques traditionnelles. Malgré le faste royal et les efforts de persuasion britanniques, Trump a maintenu ses positions controversées sur l’Ukraine et a même renforcé sa politique de désengagement vis-à-vis de l’Europe orientale.
Cette séquence diplomatique marque un tournant dans les relations transatlantiques, révélant l’inefficacité des méthodes d’influence traditionnelles face à un leadership américain qui remet en question les fondements mêmes de l’ordre géopolitique occidental établi depuis 1945. L’Europe se trouve ainsi contrainte de repenser ses stratégies d’influence et d’envisager une plus grande autonomie stratégique face à un allié américain de moins en moins prévisible.
Joël-François Dumont
Références
[01] & [02] Kettle, M. (2024, 9 mars). « Britain ‘sucking up’ to Donald Trump is a strategy doomed to humiliation. » in The Guardian.
[03] Rentoul, J. (2019, 29 novembre). « Donald Trump is a toxic friend for Britain – but we have no choice » in The Independent.
[04] & [05] Riley-Smith, B. (2024, 12 février). « Trump would ‘green light Putin to attack Nato allies’ » in The Daily Telegraph.
[06] Reuters. (2024, 18 avril). « Trump says he gets along with Putin, complains about US aid to Ukraine. »
[07] Baker, P. (2024, 11 février). « Trump Sets Off a Furor With Remark He’d ‘Encourage’ Russian Attack on NATO » in The New York Times.
[08] The Editorial Board. (2024, 12 février). « Trump’s NATO remarks are stupid and dangerous. » in The Washington Post.
[09] CNN. (2024, 12 février). « ‘It’s malpractice’: Former defense secretary reacts to Trump’s NATO comments.«
[10] The Editorial Board. (2019, 5 mars). « The Long and Short of Trump’s NATO Rant » in The Wall Street Journal.
[11] Singman, B. (2024, 13 février). « Trump says NATO countries ‘must pay their bills’ after criticism for his comments » in Fox News.
[12] Raines, T. & Haindswerth, L. (2024, 25 janvier). « How Europe can prepare for a Trump 2.0 presidency » : Chatham House.
[13] Barrie, D. (2024, 13 février). « Europe’s looming military capability and capacity challenge » : International Institute for Strategic Studies (IISS).
[14] Krastev, I. & Leonard, M. (2024, 24 janvier). « The art of the vassal: How European capitals can survive a second Trump presidency » : European Council on Foreign Relations (ECFR).
[15] Skaluba, C. (2024, 12 février). « How NATO can survive Trump 2.0 » : Atlantic Council.
[16] Harrison, T. et al. (2024, 25 janvier). « Restoring the Bipartisan Consensus on US Global Leadership » : Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Voir également :
- « Mind the Gap: Anatomie eines gescheiterten diplomatischen Vorhabens » — (2025-0919) —
- « Mind the Gap: Anatomy of a Lost Diplomatic Gamble » — (2025-0919) —
- « Mind the Gap: Anatomie d’un pari diplomatique perdu » — (2025-0919) —
In-depht Analysis:
The UK’s gamble to win over Donald Trump with royal splendor in September 2025 ended in a strategic humiliation for Europe. Completely immune to pomp and diplomatic pressure, Trump confirmed a cut in security aid to NATO’s eastern flank. He transformed the alliance into a pay-for-protection racket, handing Europe the « bill. » The visit, deemed a resounding failure, formalized the end of the « special relationship » and exposed a gaping fracture within the West.
For experts, it’s an existential alarm bell: Europe is now on its own, forced to urgently rethink its strategic autonomy in the face of an unpredictable American ally. This brutal clarification demonstrates the utter failure of European soft power against the « America First » doctrine, marking the dawn of a new era of uncertainty for transatlantic security.