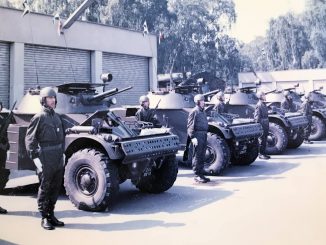Les fantômes de Sedan et de 1940 hurlent une leçon que l’Europe refuse d’entendre : le déni du réel signe toujours nos arrêts de mort. Face à Moscou, nous somnambulons vers l’abîme. Après le général Thierry Burkart, le général Fabien Mandon a osé sonner le tocsin en brisant ce silence suicidaire, posant l’ultimatum de notre survie : se réarmer moralement, quitte à « accepter de perdre nos enfants ».
Contre cette lucidité martiale se dresse une coalition de la honte : seconds couteaux politiques en quête de buzz et idiots utiles du Kremlin, unis dans un indécent concert. Ces fossoyeurs désarment les esprits et trahissent l’avenir. L’alternative est brutale : regarder la menace en face ou périr, noyés dans le sang de notre propre lâcheté.
Une analyse stratégique des cycles de l’aveuglement européen (1806-2025)
Sommaire
par Joël-François Dumont — Paris, le 24 novembre 2025
Introduction : La vérité comme arme de dissuasion
L’analyse des cycles historiques, de l’humiliation d’Auerstedt à la débâcle de 1940, démontre une loi d’airain : le refus d’écouter les sentinelles (Stoffel, Pellé, de Gaulle) conduit inéluctablement au désastre.
Aujourd’hui, l’avertissement du général Mandon sur la nécessité d’un réarmement moral n’est ni une provocation ni un cas isolé, mais s’aligne strictement sur les analyses de ses homologues européens, du général suédois Micael Bydén aux chefs du renseignement balte et allemand. Dans la plupart des pays d’Europe, les plus hauts responsables de la défense ont tenu des propos très semblables, appelant à une préparation mentale face au péril imminent. Cette lucidité stratégique n’a finalement choqué que les voix pro-russes ou complaisantes que l’on retrouve aux extrêmes de l’échiquier politique européen, préférant le confort du déni à la rudesse de la survie.
La pérennité des nations ne repose pas uniquement sur la solidité de leurs murailles ou la sophistication de leurs arsenaux, mais plus fondamentalement sur leur capacité collective à regarder la réalité en face. L’histoire militaire et politique de l’Europe, depuis l’aube du XIXe siècle jusqu’aux tensions géopolitiques exacerbées de l’année 2025, offre un champ d’étude tragique sur le coût exorbitant du déni.
La question posée — « Faut-il dire la vérité, quitte à déplaire, ou faut-il continuer de dire ce que certains ne veulent qu’entendre? » — n’est pas une interrogation philosophique abstraite. Elle constitue le nœud gordien de la survie étatique.
À intervalles réguliers, les démocraties occidentales se trouvent confrontées à des puissances révision-nistes ou impériales qui annoncent clairement leurs intentions. À chaque fois, une dialectique mortifère se met en place entre, d’une part, des sentinelles — officiers de renseignement, attachés militaires, chefs d’état-major — qui décryptent les signaux faibles et forts de la menace, et d’autre part, un appareil politique et une opinion publique qui préfèrent le confort de l’illusion à la rudesse de la lucidité.
Notre propos vise à examiner cette pathologie récurrente à travers quatre moments de bascule historique : l’humiliation prussienne de 1806 qui a germé jusqu’à la revanche de 1870, l’aveuglement doctrinal précédant 1914, l’étrange défaite de 1940 préparée par une décennie de renoncements, et enfin, la situation critique de 2024-2025 face à la menace russe.
En analysant les mécanismes du refus de la vérité, depuis les avertissements ignorés du colonel Stoffel et du colonel de Gaulle jusqu’aux alertes contemporaines du général Fabien Mandon, nous tenterons de comprendre si la « bêtise, la lâcheté ou la trahison » trop peu dénoncées sont des fatalités historiques ou des faillites morales évitables. L’évocation du général François Mermet et du serment de Bon-Encontre servira de fil rouge pour démontrer qu’il existe, au cœur même de la débâcle, une voie de résilience fondée sur l’acceptation brutale du réel.
I : La matrice de la haine – De la catastrophe d’Auerstedt à la revanche de Sedan (1806-1870)
1.1 La genèse du ressentiment : 1806 et l’humiliation de la Prusse
Pour saisir la dynamique qui a broyé l’Europe pendant un siècle et demi, il est impératif de revenir à la source du traumatisme allemand. La bataille d’Austerlitz en 1805 avait consacré le génie napoléonien, mais c’est la campagne de 1806 qui a scellé le destin des relations franco-allemandes. Napoléon, dans sa volonté hégémonique de redessiner la carte du continent, ne s’est pas contenté de vaincre militairement la Prusse ; il a cherché à l’anéantir politiquement et moralement.
La double bataille d’Iéna et d’Auerstedt, le 14 octobre 1806, fut un événement sismique. Si Iéna est restée dans les mémoires françaises, c’est à Auerstedt que l’humiliation prussienne fut la plus totale. Là, le maréchal Davout, avec un seul corps d’armée (le IIIe), a mis en déroute l’armée principale prussienne commandée par le duc de Brunswick, pourtant largement supérieure en nombre. Cette victoire, perçue comme un miracle tactique côté français, fut vécue comme une preuve de dégénérescence côté prussien.[01]
L’après-bataille fut gérée avec une brutalité diplomatique qui allait nourrir le nationalisme allemand pour les décennies à venir. Napoléon a démembré les territoires allemands pour créer des états clients, notamment le Royaume de Bavière et la Confédération du Rhin, réduisant la Prusse à une puissance de second rang.[01] Le traité de paix imposé fut draconien, amputant la Prusse de vastes territoires et lui imposant une occupation militaire humiliante ainsi que des indemnités de guerre écrasantes.
C’est dans ce creuset de la défaite absolue qu’est né le désir de revanche. Les réformateurs prussiens, tels que Scharnhorst, Gneisenau et Clausewitz, ont analysé la défaite non comme un accident, mais comme le résultat d’une faillite systémique face à la « nation en armes » française. Ils ont juré de reconstruire une armée et un État capables de rendre coup pour coup. Comme le notent les historiens, le sentiment national allemand s’est cristallisé autour de cette haine de l’occupant français et du souvenir brûlant d’Auerstedt.[01]
1.2 La mécanique de la revanche : La stratégie bismarckienne
Soixante ans plus tard, ce ressentiment n’avait rien perdu de sa virulence ; il s’était au contraire institutionnalisé. Otto von Bismarck, le « Chancelier de fer », a su canaliser cette énergie historique pour réaliser l’unité allemande. Sa phrase, prononcée au soir de la bataille de Sedan, résonne comme une sentence historique : « Il y a eu Sedan parce qu’il y a eu Auerstedt. »[02]
Cette vision cyclique de l’histoire ne s’arrêtera pas là. Cette sentence hantera la mémoire allemande bien au-delà du XIXe siècle : en 1940, Adolf Hitler tiendra à passer spécifiquement par Sedan pour répéter cette même phrase, inscrivant ainsi l’invasion nazie dans la continuité directe de cette vendetta historique.[02]
La stratégie prussienne reposait sur une préparation minutieuse, tirant les leçons des échecs passés. L’armée prussienne de 1870 n’avait plus rien à voir avec celle de 1806 : elle était devenue une machine industrielle, appuyée par un réseau ferroviaire dense pour la mobilisation et équipée d’une artillerie moderne (canons Krupp). Face à cette montée en puissance, la France impériale s’est enfermée dans une léthargie coupable, persuadée de sa supériorité naturelle héritée de la Grande Armée.
1.3 Les Cassandres ignorées du Second Empire : Le cas du colonel Stoffel
L’effondrement de 1870 est d’autant plus tragique qu’il avait été prédit avec une exactitude mathéma-tique. Les archives militaires regorgent de rapports qui, s’ils avaient été lus et compris, auraient pu changer le cours de l’histoire.
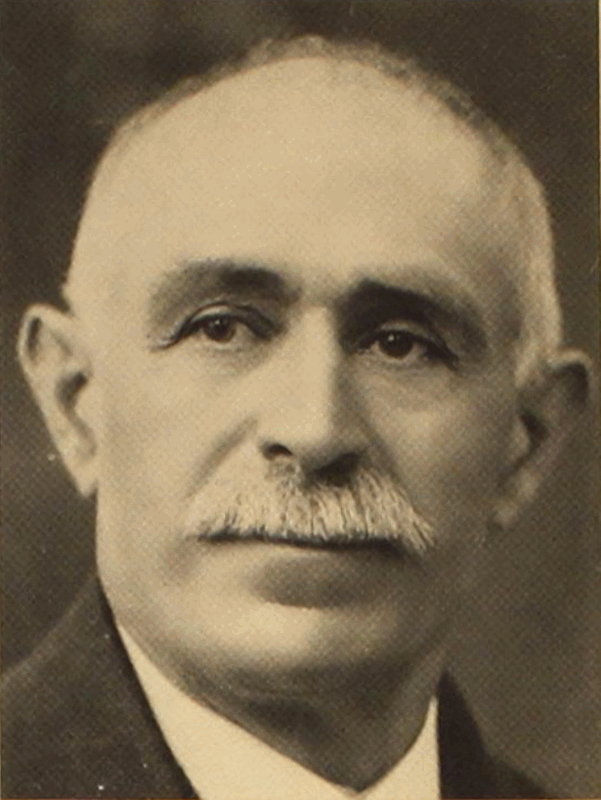
La figure centrale de cette clairvoyance malheureuse est le baron Eugène Stoffel, lieutenant-colonel et attaché militaire à Berlin de 1866 à 1870.
Stoffel n’était pas un simple observateur ; c’était un analyste de haute volée qui comprenait que la guerre moderne ne se jouait pas seulement sur le courage des soldats, mais sur l’organisation, la logistique et la technologie. Ses rapports au ministère de la Guerre et à l’Empereur Napoléon III constituent un modèle de renseignement militaire.[03]

Eugène Stoffel, (1821-1907) officier d’ordonnance de Napoléon III, attaché d’ambassade à Berlin avant que le conflit franco-prussien n’éclate. De retour en France, il est au côté de l’empereur pendant la défaite de Sedan, puis en charge de l’artillerie lourde pendant le siège de Paris en 1870.
| Domaine d’Alerte | Contenu du Rapport Stoffel (1866-1870) | Réaction Française / Conséquence |
| Capacité de Mobilisation | La Prusse peut mobiliser rapidement grâce à son organisation territoriale et ses chemins de fer. Elle peut mettre en ligne 600 000 hommes instruits. | Incrédulité. Le Maréchal Le Bœuf affirme : « Nous sommes prêts, il ne manque pas un bouton de guêtre. » |
| Artillerie | Supériorité écrasante des canons prussiens (acier, chargement par la culasse) sur les pièces françaises en bronze. | Dédain pour la technologie prussienne (« l’acier casse »). |
| État d’Esprit | La Prusse est une nation unie par le désir de guerre et la haine de la France. Elle « se propose tout simplement d’envahir notre territoire ». | Stoffel est traité d’« oiseau de mauvais augure » et de « Prussophile ». On préfère croire à la paix. |
| Commandement | L’État-major prussien est une élite intellectuelle formée à la guerre de mouvement. | Confiance aveugle dans le « génie français » et l’improvisation (le « système D »). |
Les avertissements de Stoffel se sont heurtés à un mur de suffisance et de calculs politiques à court terme. Le corps législatif, soucieux d’économies budgétaires et d’apaisement social, refusait d’envisager les réformes nécessaires (comme le service militaire obligatoire élargi). Le général Palikao, ministre de la Guerre, notait en marge des rapports de Stoffel son désaccord, préférant ses propres illusions à la réalité du terrain.[03]
Le résultat de cette surdité fut catastrophique. Lorsque la guerre éclata, la France fut submergée par le nombre et la puissance de feu, exactement comme Stoffel l’avait prédit. La capitulation de Sedan ne fut pas un accident, mais la conclusion logique d’années de déni.
II : La grande illusion et la surprise stratégique de 1914
2.1 L’oubli des leçons et le dogme de l’offensive
Après 1870, la France s’est reconstruite autour de l’idée de la « Revanche ». Paradoxalement, cette obsession n’a pas garanti une meilleure lucidité. À l’approche de 1914, l’état-major français, sous la direction du général Joffre, a développé une nouvelle forme d’aveuglement : le culte de l’offensive à outrance. Persuadés que la volonté (« le cran ») pouvait surmonter la puissance de feu, les chefs militaires ont négligé les aspects défensifs et logistiques de la guerre moderne.
Parallèlement, une erreur d’appréciation majeure a été commise concernant la stratégie allemande. Le plan Schlieffen, conçu pour contourner les forteresses de l’Est par une invasion massive à travers la Belgique neutre, reposait sur l’utilisation des réservistes en première ligne pour élargir le front. L’état-major français jugeait cette manœuvre « impossible » faute d’effectifs suffisants, refusant de croire que l’Allemagne oserait diluer ses troupes d’active avec des réservistes dès le début des opérations.
2.2 Le rapport prophétique du colonel Pellé (1913)
Pourtant, une fois de plus, la vérité était disponible sur le bureau des décideurs. Le colonel Pellé, attaché militaire à Berlin en 1913, avait succédé à Stoffel dans le rôle ingrat de Cassandre. Ses analyses, corroborées par d’autres sources de renseignement, offraient une radiographie précise des intentions allemandes.[04]
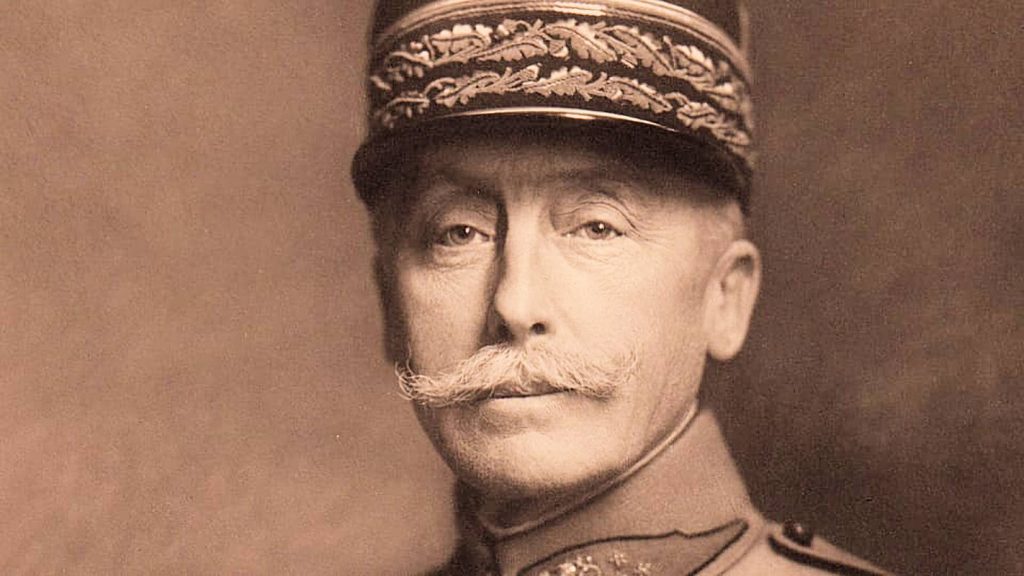

Dans un rapport daté de 1913, Pellé détaillait les préparatifs allemands à la frontière belge. Il signalait la construction de camps militaires (comme celui d’Elsenborn), de gares de débarquement surdimension-nées et de voies ferrées qui ne s’expliquaient que par une volonté de projeter des masses considérables de troupes vers l’ouest, à travers la Belgique.[04] Plus grave encore, il alertait sur l’intégration organique des réserves allemandes : l’Allemagne ne ferait pas de distinction opérationnelle entre ses corps d’armée d’active et ses corps de réserve, doublant ainsi instantanément sa force de frappe initiale.[04]
Pellé décrivait également l’état psychologique de l’Allemagne, une nation convaincue de son encerclement et prête à une guerre préventive violente. Il notait le mépris des officiers allemands pour l’armée française, jugée indisciplinée et minée par la politique.[04]
Ces rapports furent lus par le général Joffre et le Deuxième Bureau, mais leurs conclusions furent écartées car elles ne cadraient pas avec le Plan XVII, qui prévoyait une attaque frontale en Lorraine. Admettre la véracité des rapports de Pellé aurait obligé à repenser toute la stratégie française et à dégarnir l’offensive prévue pour protéger la frontière belge. On préféra donc ignorer l’alerte.
La conséquence fut la surprise stratégique d’août 1914. Les armées allemandes déferlèrent par la Belgique avec une ampleur insoupçonnée, manquant de peu de prendre Paris. Il fallut l’hécatombe de la Bataille des Frontières et le redressement miraculeux de la Marne pour éviter la défaite totale. Une fois de plus, le prix du déni se compta en centaines de milliers de vies.
III : L’étrange défaite, le prophète ignoré et le sursaut de l’honneur (1930-1940)
3.1 La décennie de l’aveuglement volontaire
Les années 1930 ont été l’âge d’or du déni. Alors qu’Hitler réarmait l’Allemagne à une vitesse vertigineuse, la France se cachait derrière la ligne Maginot et un pacifisme né de l’épuisement.
La période de l’entre-deux-guerres représente sans doute le sommet de l’aberration stratégique. Jamais les intentions d’un adversaire n’avaient été aussi clairement exposées que dans Mein Kampf, et jamais les démocraties n’avaient déployé autant d’efforts pour ne pas les voir.
Dès 1933, les services de renseignement français (le SR et le Deuxième Bureau), ainsi que les attachés militaires comme le général Renondeau à Berlin, ont fourni un flux continu d’informations sur le réarmement clandestin puis ouvert de l’Allemagne nazie. Ils ont documenté la création des divisions blindées (Panzer), la renaissance de la Luftwaffe, et la remilitarisation de la Rhénanie en 1936.
Cependant, le pouvoir politique, traumatisé par la saignée de 14-18 et paralysé par une opinion publique pacifiste, a choisi la voie de l’apaisement. En 1939, le sénateur Marcel Pellenc rédigea un rapport accablant sur l’état de l’aviation française face à la Luftwaffe, soulignant le déficit industriel et technologique critique.[05] Ce rapport, au lieu de provoquer un sursaut salutaire, fut enterré. Le mot d’ordre était de « ne pas désespérer Billancourt » et de ne pas affoler les populations. On préféra mentir sur les chiffres de production d’avions plutôt que d’avouer la vulnérabilité du pays.
3.2 La solitude du colonel de Gaulle : Le dogme contre le moteur
C’est dans ce paysage intellectuel pétrifié que le lieutenant-colonel Charles de Gaulle a tenté, seul contre sa hiérarchie, de briser le mur du conformisme. En publiant « Vers l’Armée de Métier » en 1934, il ne proposait pas seulement une réforme technique, mais une révolution doctrinale fondée sur le trinôme Vitesse-Puissance-Surprise. Il annonçait que la ligne Maginot ne suffirait pas et que le moteur à explosion avait bouleversé l’art de la guerre autant que la poudre à canon en son temps.[06]
La réaction de l’institution militaire ne fut pas le débat, mais l’excommunication. Le général Louis Maurin, ministre de la Guerre et gardien du temple de la défensive, interpella publiquement de Gaulle avec une violence qui témoigne de la fermeture d’esprit de l’époque : « Adieu, de Gaulle ! Là où je suis, vous n’avez plus votre place ! » [07]
Dans l’intimité de son cabinet, Maurin alla plus loin, menaçant l’officier insolent qui osait alerter les politiques : « Il a pris un porte-plume : Pironneau, et un phonographe : Paul Reynaud. Je l’enverrai en Corse ! »[07] Pour l’état-major, le danger n’était pas Hitler, mais celui qui remettait en cause le dogme de l’inviolabilité du front.
3.3 L’ultime avertissement : Le mémorandum de janvier 1940
L’aveuglement persista jusqu’aux portes du désastre. Le 26 janvier 1940, pendant la « drôle de guerre », de Gaulle, alors colonel commandant les chars de la Ve Armée, rédigea un dernier avertissement : le mémorandum intitulé « L’Avènement de la force mécanique ». Dans ce texte prophétique envoyé à 80 personnalités, il décrivait avec quatre mois d’avance le scénario exact de la défaite à venir. Il y détruisait l’illusion de la sécurité statique :

« La position Maginot, quelques renforcements qu’elle ait reçus […], est susceptible d’être franchie. C’est là d’ailleurs, à la longue, le sort réservé à toutes les fortifications.»[08]
Il prévenait que seule une force mécanique pouvait contrer l’attaque allemande : « Pour briser la force mécanique, seule la force mécanique possède une efficacité certaine.»[08]
La réponse du Haut-Commandement fut d’une désinvolture criminelle. Le général Georges, adjoint de Gamelin, annota le document de cette phrase qui résume la faillite d’une élite : « Intéressant mais la reconstruction n’est pas à la hauteur de la critique ! »[09]
Quatre mois plus tard, les Panzers traversaient la Meuse exactement comme de Gaulle l’avait prédit, et l’armée française s’effondrait, victime de n’avoir pas voulu écouter la vérité.
3.4 Le serment de Bon-Encontre : La lumière dans la débâcle

C’est dans ce contexte de déliquescence morale et militaire que l’épisode du serment de Bon-Encontre prend toute sa dimension historique et symbolique. Il incarne le refus du déni au moment même où l’État s’effondre.

Le 25 juin 1940, alors que l’armistice venait d’être signé et que la France était officiellement vaincue, les cadres des services spéciaux français (le SR Terre et le Contre-Espionnage), dirigés par le colonel Louis Rivet et le capitaine Paul Paillole, se sont repliés à Bon-Encontre, près d’Agen.[10]

Dans la cour du petit séminaire réquisitionné, ils ont posé un acte de désobéissance fondatrice.

Contrairement au gouvernement de Pétain qui acceptait la défaite comme un verdict définitif de l’histoire, ces hommes savaient, grâce à leur connaissance intime des forces en présence, que la guerre n’était pas finie. Ils savaient que l’Angleterre tiendrait et que les ressources des empires coloniaux et des États-Unis finiraient par peser.

Le serment de Bon-Encontre consistait en un engagement solennel à poursuivre la lutte dans la clandestinité. Concrètement, cela signifiait :
- Ne jamais livrer les archives des services secrets à l’ennemi.
- Soustraire le personnel et les agents aux griffes de la Gestapo.
- Continuer à renseigner les Alliés et préparer la revanche.
Ce serment n’est pas resté lettre morte. Il a donné naissance à des réseaux clandestins majeurs, comme le réseau « Travaux Ruraux » (TR) pour le contre-espionnage. C’est dans cette lignée que s’inscrivent les « Merlinettes », ces jeunes femmes agents de transmission formées par les services spéciaux (le surnom vient du colonel Merlin). Comme le rappellait le général François Mermet, président de l’Amicale des Anciens des Services Spéciaux (AASSDN), qui s’est investi pour qu’un hommage tardif mais réel soit rendu à la mémoire de ces femmes, âgées de 20 à 25 ans, parachutées en territoire occupé pour assurer les liaisons radio vitales.[10] Beaucoup furent arrêtées, torturées et déportées à Ravensbrück. Leur sacrifice, longtemps oublié, est aujourd’hui honoré au jardin Eugénie-Malika Djendi à Paris comme à Ravensbrück.


Le colonel Paillole aimait citer Bossuet pour résumer cette éthique :
« Le plus grand outrage que l’on puisse faire à la Vérité est de la connaître et en même temps de l’abandonner ou de l’affaiblir.»[10] Si la France avait écouté ses services de renseignement et des hommes comme de Gaulle dans les années 30 au lieu de se bercer d’illusions, elle aurait pu « se préparer » et nous épargner l’humiliation de 1940, une de plus.[10] Le chemin de l’honneur commence par le courage de la vérité.
IV : L’histoire bégaye – La menace russe et le déni européen (2024-2025)
4.1 La Suède, nouvelle Cassandre du nord
Quatre-vingts ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe se trouve dans une configuration géopolitique qui rappelle étrangement les années 30. Une puissance révisionniste, la Russie, remet en cause l’architecture de sécurité du continent. Et de nouveau, les signaux d’alerte s’accumulent, émis par des nations qui, par leur géographie, sont aux premières loges.
La Suède, rompant avec deux siècles de neutralité pour rejoindre l’OTAN, a pris la tête de ce travail de vérité. Le commandant en chef des forces armées suédoises, le général Micael Bydén, et les services de sécurité (Säpo) ont multiplié les avertissements tout au long de 2024 et 2025.
Leur message est sans ambiguïté : la Russie a « les deux yeux fixés sur l’île de Gotland. »[11] Cette île stratégique est la clé de voûte de la défense de la Baltique ; celui qui la contrôle peut verrouiller l’accès maritime aux pays Baltes et menacer la Finlande.
Le général Micael Bydén — Photo © Frankie Fouganthin

Mais l’alerte suédoise va au-delà de la géographie militaire. Elle documente une guerre hybride déjà en cours :
- L’espionnage religieux : Les services suédois ont révélé que l’Église orthodoxe russe située à Västerås était utilisée comme plateforme de renseignement.[12] L’emplacement de cette église n’est pas anodin : elle se trouve à proximité immédiate d’un aéroport stratégique, d’usines de traitement des eaux et d’installations énergétiques. C’est un exemple frappant de l’utilisation de couvertures civiles pour préparer des sabotages.
- La flotte fantôme : La marine suédoise surveille étroitement une « flotte fantôme » de pétroliers russes en mer Baltique, soupçonnés de servir de stations d’écoute flottantes et de vecteurs potentiels pour des actions contre les infrastructures sous-marines (câbles, gazoducs).[13]
- L’économie de guerre : Les rapports conjoints des services de renseignement baltes et nordiques soulignent que la Russie a basculé son économie en mode guerre. Si le rapport estonien estimait initialement que ce « boom de guerre » s’essoufflerait en 2025, les analyses plus récentes (lettonnes et suédoises) suggèrent que Moscou peut maintenir cet effort jusqu’en 2027 voire au-delà, donnant à la Russie une fenêtre d’opportunité dangereuse entre 2026 et 2030 pour tester l’OTAN.[14]
Le général Bydén a choqué ses concitoyens en déclarant : « Les Suédois doivent se préparer mentalement à la guerre. »[11] Ce n’était pas du bellicisme, mais un appel à la résilience civile, indispensable face à une guerre totale.
Avant lui, l’Inspecteur général de la Bundeswehr, le général Carsten Breuer, comme ses homologues britannique, néerlandais et belge ou encore plus récemment le chef d’état-major général des armées polonais, le général Wieslaw Kukula qui a déclaré, le 18 novembre dernier, à la suite du sabotage d’une voie de chemin de fer, que son pays était clairement entré dans une phase « d’avant-guerre » comme l’écrit le Monde dans sa dernière livrée.[15]
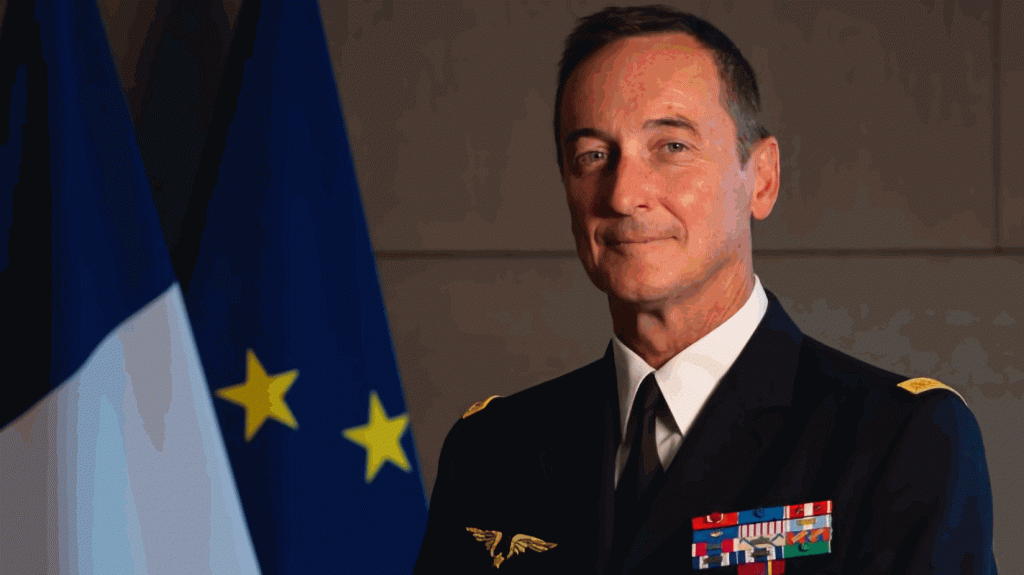
4.2 L’avertissement du général Mandon : « Accepter de perdre nos enfants »
En France, le chef d’état-major des Armées (CEMA), le général Fabien Mandon, a relayé cette inquiétude avec une gravité solennelle, tout comme l’avait fait avant lui son prédécesseur, le général Thierry Burkart. Auditionné devant les commissions de la défense de l’Assemblée nationale et du Sénat, le 22 octobre et le 5 novembre, il avait exprimé ses convictions, celles des militaires, qui rejoignent celles des chefs des services de renseignement de toute l’Europe.
Le 18 novembre invité devant le Congrès des maires de France, il a tenté de briser le mur de l’indifférence. « La Russie ne peut pas nous faire peur, si on a envie de se défendre »[15]
Le choix du Congrès des maires n’était pas fortuit. Le général Mandon sait que la résilience d’une nation en cas de conflit majeur repose sur le tissu local, sur la capacité des communes à faire face aux crises. Son discours visait à l’électrochoc de l’opinion. Il a déclaré : « Ce qui nous manque, c’est la force d’âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l’on est... Il faut accepter de perdre nos enfants. »[16]
Cette phrase terrible doit être comprise dans son contexte stratégique. La dissuasion nucléaire et conventionnelle ne fonctionne que si l’adversaire est persuadé que vous êtes prêt à aller jusqu’au bout. Si une société signale qu’elle ne tolérera aucune perte, qu’elle privilégie son confort immédiat à sa liberté future, elle devient une proie tentante.
Le général Mandon alertait sur le fait que la France dispose de « trois à quatre ans » pour se préparer à un choc de haute intensité.[16] Il ne prophétisait pas la guerre, il expliquait le prix de la paix : la crédibilité de la détermination nationale.
Il a également dénoncé la dégradation rapide de la situation internationale : « Depuis cet été, la situation s’est encore détériorée : ce que je vois, c’est que tout va de mal en pis.»[16]
V : Le « concert des pleureuses » ou la trahison des clercs modernes
5.1 Anatomie de la lâcheté politique
Face à ces avertissements fondés sur des renseignements précis et une analyse historique profonde, la réaction d’une partie de la classe politique française illustre tragiquement la permanence des réflexes de 1870 et de 1939. Un « concert des pleureuses », dans un mélange d’indignation feinte et de déni de réalité.

L’avertissement lucide du général Mandon a déclenché un spectacle honteux.
- Le déni idéologique (Jean-Luc Mélenchon et LFI) : Le leader de La France Insoumise a immédiatement réagi en dénonçant un « discours guerrier que personne n’a décidé ».[17] Il a accusé le général Mandon de sortir de son rôle, évoquant le « trouble dans l’État » et faisant référence au discours de Bayeux pour critiquer l’expression publique des militaires.[17] Cette posture relève d’un aveuglement idéologique classique : refuser de voir la menace extérieure (l’impérialisme russe) pour se concentrer sur une critique interne des institutions. C’est la répétition de l’erreur du PCF à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, considérant que la guerre « capitaliste » ne concernait pas le peuple, jusqu’à ce que les chars ennemis soient dans Paris.
- La complaisance coupable (Le Rassemblement National) : Sébastien Chenu et plusieurs cadres du RN ont remis en cause la « légitimité » du CEMA à « effrayer les Français ».[17] Cette réaction est symptomatique d’une ambiguïté persistante vis-à-vis de la Russie de Poutine. En minimisant la menace et en attaquant le messager, le RN adopte une posture qui rappelle les partisans de l’apaisement des années 30, ceux qui pensaient qu’on pouvait s’entendre avec les régimes totalitaires au nom d’un réalisme nationaliste mal placé.
- La déconnexion morale (Ségolène Royal et une certaine gauche) : Ségolène Royal a critiqué les propos du général sur les réseaux sociaux, évoquant un risque de « virilisme toxique » et d’atteinte au moral de la nation.[17] Fabien Roussel (PCF) a jugé le discours « inacceptable ».[17] Ces réactions témoignent d’une profonde incompréhension de la nature tragique de l’histoire. Elles reflètent une vision du monde où la paix serait un état naturel garanti, et où l’évocation du sacrifice serait une pathologie masculine dépassée. C’est oublier, comme le rappelait Churchill, que le refus du combat n’évite pas la guerre, il ne fait que la rendre plus désastreuse.
- Le déni n’est pas l’apanage de la gauche. À la droite de l’orchestre, le spectacle est tout aussi pathétique, la cacophonie tout aussi affligeante : Luc Ferry semble avoir fait exploser son propre « déconomètre » ! Grand habitué des soliloques sur CNews ou LCI, il a rejoint le quarteron d’anciens ministres « poutinolâtres » mondains, aux côtés de Philippe de Villiers et Thierry Mariani. On croirait assister au casting d’un remake tragique du Dîner de cons de Francis Veber, où l’aveuglement le dispute à la suffisance. En rejoignant le chœur des pleureuses, Ferry étale une méconnaissance coupable de l’Histoire sur les plateaux de CNews et LCI.
5.2 Le Poids des mots, le choc des réalités
Face à ces porphyrogénètes de salon, la figure de Jean-Marie Bockel se dresse comme un reproche vivant. Lui ne joue pas à la guerre : il a perdu un fils au Mali pour nos libertés. Le contraste n’en est que plus saisissant entre la honteuse légèreté des uns, qui ne risquent que leur réputation sur les plateaux télé, et l’honneur tragique d’un père qui sait que le prix de notre sécurité n’est pas une métaphore, mais une réalité sanglante.
5.3 Le buzz contre la survie
Le drame contemporain réside dans la primauté de l’émotion médiatique sur la réflexion stratégique. Dire la vérité — que la liberté a un prix, parfois sanglant — est devenu inaudible dans une société de l’instant. Les responsables politiques qui hurlent au scandale devant les propos du général Mandon ne protègent pas la population ; ils la désarment moralement. Ils cultivent une vulnérabilité psychologique que les services de renseignement russes, experts en guerre hybride, savent parfaitement exploiter.
Ce refus d’entendre la vérité est, selon les termes mêmes du général Mermet, une forme de trahison. Trahison envers l’histoire, qui nous a montré où mène la faiblesse. Trahison envers les générations futures, qui risquent de payer le prix fort de notre imprévoyance. Comme en 1939, on préfère ne pas « désespérer Billancourt » (ou aujourd’hui, l’électeur consommateur), quitte à livrer le pays désarmé au choc qui vient.
Conclusion : La vérité comme seul chemin d’honneur
L’histoire est un juge implacable qui ne retient pas les intentions, mais les résultats. La trajectoire qui mène d’Auerstedt à Sedan, de la Belle Époque aux tranchées de 1914, et de l’aveuglement de Munich à la débâcle de 1940, démontre une loi d’airain : le déni de la réalité se paie toujours par le sang.
À chaque carrefour critique, des hommes ont eu le courage de dire la vérité. Le colonel Stoffel a crié dans le désert face à la puissance prussienne. Le colonel Pellé a décrit avec précision la mécanique de l’invasion de 1914. Le colonel de Gaulle a décrit, plan à l’appui, l’invasion mécanique allemande, se heurtant au mépris de ses chefs. Et à Bon-Encontre, le colonel Rivet, le capitaine Paillole ont prouvé que l’honneur consistait à regarder la défaite en face pour mieux la surmonter.
Aujourd’hui, les généraux Bydén et Mandon, appuyés par les services de renseignement européens, reprennent ce flambeau ingrat. Ils nous disent que l’hiver géopolitique arrive, que la Russie se prépare à une confrontation longue, et que nos sociétés doivent se réarmer moralement. Le « concert des pleureuses » qui tente de couvrir leur voix par des polémiques stériles porte une lourde responsabilité devant l’histoire.
Annexes : Données comparatives des alertes stratégiques
| Époque | Lanceur d’Alerte | Contenu de l’Alerte (Vérité dérangeante) | Réaction Politique / Médiatique (Déni) | Conséquence historique |
| 1866-1870 | Colonel Stoffel | « La Prusse va nous envahir avec 600 000 hommes et des canons supérieurs. » | « Oiseau de mauvais augure », mépris des capacités prussiennes. | Défaite de Sedan, perte de l’Alsace-Lorraine, fin du Second Empire. |
| 1911-1913 | Colonel Pellé | « L’Allemagne passera par la Belgique en utilisant ses réserves en 1ère ligne. » | Refus de changer le Plan XVII, mépris des réserves allemandes. | Surprise d’août 1914, invasion, guerre de 4 ans. |
| 1934 | Colonel de Gaulle | « Le moteur bouleverse la guerre. Il faut une armée de métier mécanique. » | Général Maurin : « Adieu de Gaulle! Là où je suis, vous n’avez plus votre place! » | Occasion manquée de moderniser l’outil militaire. |
| Janv. 1940 | Colonel de Gaulle | « La position Maginot sera franchie. Il faut une force mécanique de contre-attaque. » | Général Georges : « Intéressant mais la reconstruction n’est pas à la hauteur de la critique. » | Débâcle de mai 1940, Occupation. |
| 1933-1939 | 2ème Bureau | « Hitler prépare la guerre totale. Notre aviation est dépassée (Rapport Pellenc). » | « Ne pas désespérer Billancourt », politique d’apaisement. | Défaite de 1940 (Sursaut : Serment de Bon-Encontre). |
| 2024-2025 | Généraux Burkart / Mandon / Bydén /Breuer | « La Russie vise Gotland et l’Europe. Il faut accepter de perdre nos enfants. » | « Discours guerrier » (LFI), « Virilisme toxique » (Royal), « Illégitime » (RN). | En suspens… Risque de conflit majeur 2027-2030. |
Tableau des indicateurs de menace (2025)
| Indicateur | Détails de l’Alerte (Sources suédoises et françaises) |
| Guerre hybride | Utilisation de l’église de Västerås (Suède) pour l’espionnage près d’infrastructures critiques. « Flotte fantôme » en Baltique. |
| Économie de Guerre | La Russie maintient son effort de guerre (boom économique militaire) au moins jusqu’en 2027, contredisant les espoirs d’effondrement rapide. |
| Cible Géographique | L’île de Gotland (Suède) identifiée comme clé de voûte de la Baltique. Menace sur les Pays Baltes. |
| Préparation Civile | Nécessité d’une résilience locale (Congrès des Maires en France, brochures de préparation en Suède). |
Si nous voulons éviter que 2027 ne devienne notre nouveau 1940, il faut impérativement écouter ces avertissements. Il faut accepter la vérité, quitte à déplaire. Car comme le disait le général Mermet après le colonel Paillole, citant Bossuet, « l’abandon de la vérité est le prélude à toutes les servitudes.» Seule la lucidité, aussi douloureuse soit-elle, peut nous épargner le verdict du fer et du feu.
Épilogue : Une voix venue de la nuit
Pour conclure, il est glaçant de relire la lettre que Maxime Du Camp adressait à Gustave Flaubert le 19 septembre 1870.[18] Alors que la France s’effondrait face à la Prusse, il posait un diagnostic d’une brûlante actualité sur une nation ivre de ses propres illusions, plus prompte à discourir qu’à se battre. Ce n’est pas seulement la force militaire qui a failli, mais l’armature morale. Avec une amertume prophétique, il écrivait : « Nous mourons de notre relâchement des mœurs, de notre ignorance, de notre vanité et de notre horrible manie de la phrase.» Le parallèle avec notre époque est terrifiant. Comme ces ancêtres qui refusaient de voir le péril, nous nous payons de rhétorique face à la menace russe, oubliant cette leçon funèbre que Du Camp hurlait déjà sur les ruines de l’Empire : « Nous avons cru que le mot remplaçait la chose.» Puisse cet écho d’outre-tombe nous réveiller avant que l’Histoire ne bégaye une fois de trop…
Joël-François Dumont
Sources et légendes
[01] Theatrum Belli, 14 octobre 1806 : bataille d’Auerstedt.
[02] European Security, « D’une hostilité séculaire à une alliance fondatrice » (2025-0926).
[03] Gallica BnF, Rapports militaires écrits de Berlin 1866-1870 par le Colonel Baron Stoffel.
[04] Cairn.info, Un avertissement ignoré : le colonel Pellé et le plan Schlieffen.
[05] Sénat.fr, Comptes rendus des débats – Mention du Rapport Pellenc.
[06] Histoire en citations, Portrait de Charles de Gaulle en citations.
[07] Interforum, Mémoires et documents sur la période 1934-1940 (Citation général Maurin).
[08] Enseigner de Gaulle, Mémorandum adressé par le colonel de Gaulle le 26 janvier 1940.
[09] Cairn.info, Les présidents et la guerre (Annotation Georges).
[10] European-Security : « Bon-Encontre : le chemin de l’honneur et de la Résistance (2021-1011) & AASSDN.
[11] Telegrafi, The commander of the Swedish army: Putin aims to control the Baltic Sea.
[12] The Moscow Times, Sweden Cuts Support for Russian Church After Intelligence Warnings.
[13] European Parliament, Russia’s shadow fleet: Size, impact and associated risks.
[14] PISM, Baltic and Nordic States Assess the Russian Military Threat.
[15] Élise Vincent in Le Monde daté des 23 & 24 novembre p.5 : « Les propos du général Mandon, une position partagée en Europe : En déclarant qu’il fallait « accepter de perdre ses enfants » en cas de conflit avec la Russie, le militaire s’inscrit dans la ligne de ses homologues ».
[16] Watson.ch, Le discours «guerrier» du chef d’Etat-major français passe mal.
[17] Le Journal du Dimanche, « Mélenchon s’insurge contre les propos du chef d’état-major des armées »
Voir également :
- « The Tyranny of Denial and the Courage of Truth » — (2025-1124)
- « Die Tyrannei der Verleugnung und der Mut zur Wahrheit » — (2025-1124)
- « La tyrannie du déni et le courage de la vérité » — (2025-1124
Décryptage :
L’Histoire est un juge de sang : de Sedan à 1940, elle condamne sans appel les nations qui méprisent leurs sentinelles. Les morts de 1940 nous contemplent : ignorer la menace, c’est choisir le désastre. Pourtant, face à la Russie, l’Europe dort encore. Le chef d’état-major des armées est dans son rôle quand il dit la vérité crue : la dissuasion exige d’être prêt à « perdre nos enfants ».
En face ? Une caste de politiciens médiocres préfère hurler au scandale. Alliés objectifs de la propagande russe, ces marchands d’illusions nous vendent du confort quand il faudrait forger des épées. Un concert de pleureuses, une alliance sordide de seconds couteaux de la politique en mal de buzz et de relais pro-russes qui, par lâcheté, désarment moralement la nation. Ce pacifisme de façade est criminel. Refuser de voir la guerre qui vient, c’est signer notre arrêt de mort. Le choix est simple : la lucidité ou le sang. En nous préparant, nous pourrons peut-être l’éviter.
Cette trahison morale a un prix, et il est déjà fixé. Il n’y a plus de place pour le mensonge : soit nous affrontons la réalité, soit nous paierons notre aveuglement de notre vie.