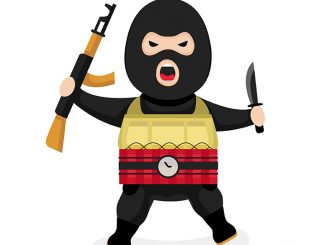Avec Donald Trump, la politique est un spectacle dont il écrit le scénario chaque matin. Depuis son retour, le 47e président a confirmé sa réputation : s’attendre à tout, et surtout à son contraire. Entre des déclarations décousues depuis un Bureau Ovale aux allures de studio de télé-réalité, et ses tweets lâchés depuis son réseau social personnel – une forteresse sans contradiction –, le style est unique. Des tweets qui, par leur finesse, rappellent les flatulences de nos ânes corses après un repas trop riche en herbes du maquis.
Dans ce climat, la question posée par Hedy Belhassine sur les chances de Trump au Nobel de la Paix semblait surréaliste. La réaction du comité norvégien, un communiqué glacial et sans équivoque, ne s’est pas fait attendre. Or, quelques jours plus tard, l’imposant porte-avions nucléaire USS Gerald Ford paradait en mer de Norvège.[*] Fallait-il y voir un lien de cause à effet ? Une dizaine de lecteurs nous ont interpellés sur cette « coïncidence ». La question méritait d’être examinée. Voici notre analyse.
Dissuasion dans le grand Nord et quête du Nobel : Analyse des constantes de la puissance américaine
Table of Contents
par Joël-François Dumont — Paris, le 28 août 2025 —
Introduction : Déconstruction d’une hypothèse et redéfinition de la problématique
Existe t-il un lien causal direct between une décision attribuée à Donald Trump – le déploiement du porte-avions USS Gerald R. Ford en mer de Norvège – et une motivation psychologique – une « phobie » du prix Nobel de la paix. Une analyse rigoureuse des faits s’impose.

Premièrement, l’attribution présidentielle de cette décision est incorrecte. Le déploiement du groupe aéronaval de l’USS Gerald R. Ford en mer de Norvège dans le Grand Nord a eu lieu en mai et juin 2023.[01][02][03] À cette période, le président des États-Unis était Joe Biden. Donald Trump, bien qu’il ait présidé à la cérémonie de mise en service du navire en juillet 2017, n’était plus en fonction et n’a donc pas pu ordonner ce mouvement spécifique.[04][05] Le premier déploiement opérationnel du porte-avions n’a d’ailleurs eu lieu qu’à l’automne 2022.[04]
Deuxièmement, la nature de l’ambition de Donald Trump est mal caractérisée. Le terme de « phobie », est-il le plus approoprié ? Toutes ses déclarations démontrent une quête active, voire obsessionnelle, pour l’obtention du prix Nobel de la paix.[06][07][08] Trump considère cette récompense comme une reconnaissance qui lui est due, se comparant favorablement à son prédécesseur Barack Obama et y voyant la validation ultime de son approche diplomatique singulière.[06][09]
Une fois ce lien causal direct invalidé, une question analytique plus profonde et pertinente émerge. Au-delà des personnalités présidentielles et de leurs styles distincts, existe-t-il des continuités dans la stratégie de puissance américaine?[*]

Le déploiement du Gerald Ford sous l’administration Biden et la doctrine de la « Paix par la Force » prônée par Donald Trump sont-ils, en réalité, deux manifestations différentes d’un même paradigme de politique étrangère, un paradigme fondé sur la démonstration de la supériorité militaire comme principal outil diplomatique? Nous allopns tenter d’explorer cette problématique en analysant d’abord le contexte stratégique de ce déploiement naval, puis la logique de la doctrine Trump, avant de mettre en lumière les convergences et divergences fondamentales de la politique de puissance américaine.
I : Le déploiement de l’USS Gerald R. Ford dans le grand Nord : Une démonstration de force dans un contexte de tensions accrues
Le déploiement du plus moderne des porte-avions américains dans les eaux de l’Arctique en 2023 n’était pas une simple visite de courtoisie. Il s’agissait d’une opération militaire soigneusement planifiée, s’inscrivant dans une stratégie plus large de l’OTAN visant à répondre à l’évolution du paysage géopolitique dans le grand Nord.
Chronologie d’une mission stratégique (mai-juin 2023)
La mission du groupe aéronaval (Carrier Strike Group – CSG) de l’USS Gerald R. Ford (CVN-78) s’est déroulée selon un calendrier précis, chaque étape étant porteuse d’une signification stratégique. Le navire, présenté comme le plus récent et le plus avancé de la marine américaine et représentant un « saut générationnel » dans la capacité de projection de puissance, a quitté sa base de Norfolk pour un déploiement programmé dans la zone de responsabilité du Commandement européen des États-Unis (EUCOM).[02][03][10]

L’escale à Oslo, débutant le 24 mai 2023, a constitué un moment fort de ce déploiement. Il s’agissait de la première visite d’un porte-avions américain en Norvège depuis plus de 65 ans, un événement hautement symbolique qui a bénéficié d’une large couverture médiatique et a été marqué par des réceptions officielles soulignant son importance diplomatique.[02][03][11]
Après cette escale, le groupe aéronaval a entamé la phase la plus opérationnelle de sa mission. Début juin 2023, il a mené des opérations en mer de Norvège et navigué dans le grand Nord, passant sous le commandement direct de l’OTAN le 5 juin.[01][12] Cette phase a coïncidé avec le début de l’Exercice Arctic Challenge, le 29 mai, une série de manœuvres aériennes de grande ampleur réunissant près de 150 appareils de 14 nations alliées.[13]
Tableau 1 : Chronologie détaillée du déploiement de l’USS Gerald R. Ford (Mai-Juin 2023)
| Date | Événement | Lieu | Signification |
| 24 mai 2023 | Arrivée dans le fjord d’Oslo | Oslo, Norvège | Première visite d’un porte-avions américain en 65 ans, symbole du renforcement des liens bilatéraux.[02][03] |
| 29 mai 2023 | Début de l’Exercice Arctic Challenge | Grand Nord | Manœuvres aériennes conjointes avec 14 pays, démontrant la capacité d’opération à grande échelle de l’Alliance.[13] |
| 3 juin 2023 | Opérations aériennes (lancements/récupérations d’hélicoptères) | Mer de Norvège | Démonstration des capacités opérationnelles du groupe aéronaval dans un environnement arctique exigeant.[12] |
| 5 juin 2023 | Transfert du groupe aéronaval sous commandement de l’OTAN | Grand Nord | Illustration de la capacité de l’Alliance à intégrer les moyens militaires américains les plus avancés dans sa structure de commandement.[01] |
Les raisons officielles : Interopérabilité et réassurance au sein de l’OTAN
Les communications officielles de la marine américaine et de l’OTAN ont présenté ce déploiement sous le triple sceau du partenariat, de l’interopérabilité et de la réassurance. La visite visait à renforcer la collaboration avec la Norvège, un allié jugé stratégique pour la sécurité de l’Arctique et de l’Atlantique Nord.[03]
L’objectif principal était de s’entraîner aux côtés des forces de l’OTAN pour affiner les tactiques, techniques et procédures communes, augmentant ainsi l’interopérabilité de l’Alliance.[03][11] Le fait que le groupe aéronaval ait navigué avec le Standing NATO Maritime Group One et que son commandement ait été temporairement transféré à l’OTAN illustre cette volonté d’intégration poussée.[01][11]

Enfin, la mission portait un message politique fort de cohésion et de garantie de sécurité. Le ministre norvégien de la Défense, Bjørn Arild Gram, a lui-même qualifié la visite d' »expression claire des garanties de sécurité que nous avons par l’OTAN« .[03][11] Dans un contexte de tensions ravivées en Europe, il s’agissait de rassurer les alliés, en particulier ceux du flanc nord, de l’engagement indéfectible des États-Unis envers la défense collective.
Les impératifs géopolitiques : Contenir la Russie dans l’Arctique
Au-delà des justifications officielles, le déploiement du P.A. Gerald Ford répondait à des impératifs géopolitiques pressants, principalement liés à la posture de la Russie. Depuis la fin de la Guerre froide, l’Arctique, autrefois une zone démilitarisée de coopération, fait l’objet d’un réinvestissement militaire massif de la part de Moscou.[14] Les autorités russes ne considèrent plus cet espace comme un enjeu diplomatique, mais essentiellement comme un théâtre militaire, y déployant de nouvelles unités navales et réactivant d’anciennes bases.[14][15]

Cette remilitarisation s’explique par l’importance stratégique croissante de la région. La fonte des glaces, conséquence du changement climatique, ouvre de nouvelles routes maritimes, notamment la « route du Nord », et donne accès à d’immenses ressources naturelles. Le contrôle de ces nouveaux « points de passage obligés » est devenu un enjeu de pouvoir majeur, une priorité pour la Russie mais aussi pour la Chine, qui cherche à y projeter son influence.[15][16][17]
Dans ce contexte, l’envoi du plus puissant porte-avions du monde dans la région constitue un acte de dissuasion non équivoque adressé à Moscou. Ce n’est pas une simple visite, mais le point culminant d’un pivot stratégique de l’OTAN vers le Grand Nord. La rupture d’un statu quo de 65 ans signale une réévaluation fondamentale de l’importance de la région. Le déploiement du Gerald Ford est la manifestation la plus visible d’une nouvelle doctrine de défense de l’Alliance qui identifie son flanc nord comme une zone de confrontation potentielle.

De plus, le choix spécifique de l’USS Gerald R. Ford est en soi un message. En déployant son atout naval le plus moderne, Washington ne se contente pas de montrer sa présence ; il met en exergue un écart technologique et capacitaire avec la marine russe, dont l’unique porte-avions est vieillissant. Cette démonstration de supériorité vise à compliquer le calcul stratégique de la Russie et à renforcer la crédibilité de la dissuasion de l’OTAN, créant ce que les analystes nomment un « dilemme de sécurité », où chaque renforcement d’un camp est perçu comme une menace par l’autre.[14]
II : La doctrine Trump : Entre « paix par la force » et l’obsession du Nobel
La politique étrangère de Donald Trump, souvent résumée par le slogan « America First », repose sur une philosophie distincte, un mélange de démonstration de force, de vision transactionnelle des relations internationales et d’une quête personnelle de prestige, incarnée par son désir d’obtenir le prix Nobel de la paix.
Définir la « paix par la force » : Une approche transactionnelle du pouvoir
La doctrine Trump est souvent décrite comme un « jeu d’équilibrisme » qui n’est ni purement isolationniste, ni ouvertement interventionniste.[18] Elle rejette les engagements militaires prolongés et coûteux (« protracted war ») qui ont caractérisé la politique américaine post-11 septembre, mais elle se garde bien du retrait total prôné par un isolationnisme strict.[18][19]
Au cœur de cette doctrine se trouve une utilisation ciblée et chirurgicale de la force militaire. La puissance américaine n’est pas un outil de construction d’un ordre mondial, mais un levier utilisé pour atteindre des objectifs « étroits, atteignables et définis avec précision ».[18] Il s’agit de démonstrations de force, qu’elles soient militaires ou économiques (par le biais de droits de douane), visant à créer un rapport de force écrasant avant même d’entamer une négociation.
Cette approche s’accompagne d’un unilatéralisme assumé. La vision de Trump des relations interna-tionales est celle d’un jeu à somme nulle, où le multilatéralisme et les institutions internationales sont perçus comme des entraves et des fardeaux.[18] Les alliances ne sont pas considérées à l’aune de valeurs communes, mais de leur « utilité stratégique » immédiate.[18][20] L’objectif n’est pas le partage du fardeau (« burden sharing ») mais son transfert pur et simple (« burden-shifting ») vers les alliés, sommés de payer pour leur propre sécurité sous peine de voir la garantie américaine remise en question.[21]
Le prix Nobel comme outil de validation suprême
Cette vision du monde est inextricablement liée à une ambition personnelle : obtenir le prix Nobel de la paix. Donald Trump exprime ouvertement son désir pour cette récompense, se plaignant d’un traitement inéquitable et estimant que ses succès diplomatiques le méritent amplement.[06][07] Cette quête est alimentée par une rivalité évidente avec Barack Obama et un besoin profond de légitimation sur la scène internationale.[08][22]
Pour justifier sa candidature, il met en avant une série de « deals » de paix et de cessez-le-feu qu’il revendique avoir personnellement négociés.[06] La liste inclut les Accords d’Abraham normalisant les relations entre Israël et plusieurs pays arabes, ainsi que des médiations prétendument réussies entre la Serbie et le Kosovo, l’Inde et le Pakistan, ou encore l’Arménie et l’Azerbaïdjan.[06][08][23] Il s’appuie pour cela sur le soutien de dirigeants internationaux, comme Benjamin Netanyahu, qui proposent sa nomination, souvent dans une logique transactionnelle visant à s’attirer les bonnes grâces de Washington.[06][08][09]

Cette quête n’est pas une simple vanité, mais un objectif stratégique. L’ordre international libéral, que Trump méprise, repose sur le multilatéralisme et la diplomatie, dont le prix Nobel est le symbole par excellence. En cherchant à obtenir ce prix, Trump ne vise pas à rejoindre le consensus, mais à le coopter. Il veut s’approprier le symbole le plus prestigieux de l’ordre existant pour prouver que sa méthode anti-libérale – unilatérale et transactionnelle – est supérieure. L’obtention du Nobel ne serait pas seulement une victoire personnelle, mais la validation idéologique de sa rupture avec la tradition diplomatique américaine.
Le paradoxe de la doctrine : Utiliser la menace pour négocier la « paix »
La doctrine de la « Paix par la Force » repose sur un paradoxe fondamental : utiliser la menace de la guerre pour obtenir une paix définie selon ses propres termes.[24] La force militaire et la pression économique sont les leviers qui amènent les adversaires à la table des négociations.[19][22]
Cependant, une analyse plus fine de ses « succès » diplomatiques révèle que ce que Trump qualifie de « paix » s’apparente souvent à une simple « cessation des hostilités ».[22] L’objectif n’est pas la résolution patiente et durable des causes profondes d’un conflit, mais la conclusion d’un « deal » rapide, spectaculaire et visible, qui peut être présenté comme une victoire personnelle.
Cette méthode crée une boucle de rétroaction. La démonstration de force est nécessaire pour justifier l’ouverture de négociations, et les négociations, même si elles n’aboutissent qu’à des résultats superficiels, sont nécessaires pour justifier la démonstration de force initiale. Dans ce schéma, le prix Nobel de la paix n’est pas comme le dit le général François Mermet « une récompense pour la paix, mais le couronnement de la méthode elle-même ».[] Il serait la preuve ultime que l’approche coercitive et transactionnelle d' »America First » est la voie la plus efficace pour la paix mondiale.[24]
III : Synthèse et analyse comparative : Continuités et ruptures dans la politique de puissance américaine
En juxtaposant le déploiement du Gerald Ford sous l’administration Biden et la doctrine de Donald Trump, il est possible de discerner à la fois des ruptures de style manifestes et des continuités stratégiques profondes qui transcendent les alternances politiques à Washington.
Une continuité stratégique fondamentale face à la Russie
Malgré une rhétorique parfois ambiguë de Donald Trump à l’égard de Vladimir Poutine, son administration a, dans les faits, maintenu une posture de dissuasion face à la Russie. Le programme European Deterrence Initiative (EDI), destiné à renforcer la présence militaire américaine en Europe, a même connu son apogée budgétaire sous sa présidence.[21] L’administration Biden, bien que beaucoup plus ferme et cohérente dans son discours, s’inscrit dans la continuité de cette politique de confinement de la menace russe.[25][26]
La différence réside dans la méthode, non dans l’objectif final. Joe Biden utilise le cadre multilatéral de l’OTAN et le langage de la coopération pour présenter un front uni et rassurer les alliés.[01][11] Donald Trump, lui, privilégiait la pression bilatérale et la menace de retrait pour contraindre les alliés à augmenter leurs dépenses militaires.[21][27] Dans les deux cas, cependant, le but est le même : renforcer le dispositif militaire occidental face à la Russie. La divergence apparente entre les politiques des deux présidents masque une convergence structurelle, dictée par une perception partagée au sein de l’appareil de défense américain de la nécessité de répondre à la compétition entre grandes puissances. Cette analyse institutionnelle, qui identifie la Russie et la Chine comme les défis stratégiques majeurs, persiste d’une administration à l’autre.[26][28]
Le déploiement du Gerald Ford sous Biden et l’augmentation du budget de l’EDI sous Trump ne sont donc pas des politiques contradictoires, mais deux réponses tactiquement différentes à la même menace stratégique perçue.
Tableau 2 : Comparaison des approches de politique étrangère (Biden vs. Trump) envers l’OTAN et la Russie
| Thème | Administration Trump | Administration Biden |
| Rhétorique sur l’Article 5 | Remise en question conditionnelle, approche transactionnelle. | Engagement « sacré » et inconditionnel. |
| Partage du fardeau | Pression maximale, menaces de retrait pour forcer les 2% de dépenses.[21] | Incitation à la coopération, valorisation des efforts consentis. |
| Dissuasion face à la Russie | Dissuasion par la force unilatérale, combinée à un dialogue personnel avec Poutine. | Dissuasion par la cohésion de l’Alliance et le renforcement du flanc Est.[03][25] |
| Utilisation des déploiements militaires | Outil de pression sur les alliés et de levier de négociation bilatérale. | Outil de réassurance des alliés et de démonstration de la défense collective. |
Projection de puissance : Le dénominateur commun de la diplomatie américaine
Le déploiement d’un groupe aéronaval est l’incarnation même de la projection de puissance américaine. Cet outil reste central, quelle que soit l’administration en place. Sous Joe Biden, il sert à la réassurance des alliés et à la dissuasion dans un cadre multilatéral.[03] Sous une présidence Trump, le même porte-avions aurait probablement servi de « gros bâton » dans une négociation, un levier de pression unilatéral.
L’analyse comparative révèle que la puissance militaire demeure le principal instrument de la politique étrangère américaine. La véritable rupture ne se situe pas entre l’engagement et le retrait, mais dans la finalité de l’usage de cette puissance : est-elle utilisée pour maintenir et renforcer l’ordre international libéral (Biden) ou pour le perturber afin d’en renégocier les termes à son avantage (Trump)?.[28][29]
Scénario contrefactuel : Le déploiement du Gerald Ford sous une présidence Trump
Imaginons un instant que le déploiement du Gerald Ford en Norvège ait eu lieu sous une administration Trump. La rhétorique et l’utilisation stratégique auraient été radicalement différentes. Le déploiement n’aurait pas été présenté comme un engagement envers la cohésion de l’OTAN, mais comme une démonstration de la force américaine que les alliés européens sont incapables d’égaler. Donald Trump l’aurait sans doute utilisé pour fustiger publiquement les membres de l’Alliance ne respectant pas l’objectif de 2% de leur PIB en dépenses de défense, arguant que les États-Unis assument seuls le véritable fardeau de la sécurité européenne.[21][27]
Plutôt que de s’intégrer dans la structure de commandement de l’OTAN, le porte-avions aurait pu être le prélude à une offre de médiation unilatérale de Trump entre l’OTAN et la Russie, se positionnant en arbitre suprême. Conformément à son approche transactionnelle, il aurait pu lier ce déploiement à des exigences commerciales ou à des concessions politiques de la part de la Norvège ou d’autres alliés, mélangeant sans distinction les dossiers sécuritaires et économiques.[29] Paradoxalement, cette approche brutale de Trump envers l’OTAN, bien que perçue comme destructrice, a accéléré une prise de conscience en Europe. La menace de voir la garantie de sécurité américaine s’effriter, combinée à l’invasion de l’Ukraine, a provoqué un « électrochoc » qui a poussé de nombreux alliés à enfin atteindre leurs objectifs de dépenses.[21] L’administration Biden a donc hérité d’une alliance militairement plus consciente et potentiellement plus robuste, rendant possible des actions de dissuasion collective crédibles comme le déploiement du Gerald Ford.
Conclusion : Au-delà des présidents, les constantes de la stratégie américaine
En conclusion, le lien causal direct suggéré par la question initiale est factuellement impossible. Le déploiement de l’USS Gerald R. Ford en mer de Norvège fut une décision de l’administration Biden, et non de Donald Trump. De plus, l’ambition de ce dernier n’est pas d’éviter le prix Nobel de la paix, mais au contraire de l’obtenir à tout prix pour valider sa vision du monde.
Cependant, l’analyse comparative de ces deux éléments – un acte de politique étrangère de l’administration Biden et la doctrine de son prédécesseur – révèle des liens thématiques profonds. Le déploiement du Gerald Ford et la doctrine de la « Paix par la Force » sont deux facettes d’une même réalité immuable : la centralité de la puissance militaire comme outil premier et ultime de la politique étrangère américaine.
La véritable dichotomie entre les deux approches ne se situe pas entre l’action et l’inaction, mais dans la finalité de cette projection de puissance. Pour l’administration Biden, elle vise à renforcer et à défendre un ordre multilatéral fondé sur des alliances et des valeurs partagées. Pour Donald Trump, elle a pour but de démanteler cet ordre au profit d’un système de « deals » bilatéraux dictés par le rapport de force, à l’avantage exclusif des États-Unis. Le même instrument – un porte-avions de la classe Gerald Ford – peut ainsi servir deux visions du monde radicalement opposées, tout en répondant à des impératifs stratégiques de long terme qui, eux, transcendent les administrations et définissent les constantes de la puissance américaine sur la scène mondiale.
La question posée par nos fidèles lecteurs nous a donné l’opportunité de cette réflexion, quii n’en doutons pas, fera progresser le débat. Qu’ils en soient remerciés !
Joël-François Dumont
Sources et légendes
[*] « Si vous voulez savoir ce qui se passe d’important dans le monde, et où, regardez où sont les porte-avions américains » disait l’amiral Labouerie. Pour le vice-amiral Christian Girard : « L’outil militaire est au service de la politique. Le porte-avions est le moyen le plus souple et le plus puissant de la servir en démontrant la puissance navale et la puissance aérienne combinées, là on le veut, quand on le veut et le temps qu’on veut. C’est l’ outil majeur de la dissuasion conventionnelle à vocation mondiale. C’est l’outil militaire par excellence de l’empire la mer au XXI e siècle comme il l’était au XXe siècle Il ne faut pas oublier qu’on dit un porte-avions mais c’est en réalité un groupe aéronaval très complexe qui associe des sous-marins d’attaque et de nombreux navires de surface anti sous et anti aériens et des moyens aériens basés à terre pour assurer la totale domination de l’espace aéromaritime y compris sous la mer sur des distances considérables, équivalentes à un peu moins d’un tiers du bassin méditerranéen par exemple. Il faut une puissance industrielle et financière considérable pour être en mesure de construire, d’entretenir de tels moyens. Seuls les Etats-Unis, demain la Chine, en sont capables à cette échelle.»
[**] Entretien avec le général d’armée aérienne François Mermet.
[01] NATO. « US aircraft carrier Gerald R. Ford comes under NATO command. » 5 juin 2023.
[02] U.S. Naval Forces Europe-Africa Public Affairs. « USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group Arrives in Oslo for Port Visit. » 24 mai 2023.
[03] Reuters. « USS Gerald R. Ford, world’s largest aircraft carrier, arrives in Oslo. » 24 mai 2023.
[04] U.S. Department of Defense. « Ford Carrier Strike Group Departs for First Full Deployment. » 4 octobre 2022.
[05] The White House Archives (Trump Administration). « Remarks by President Trump at the Commissioning Ceremony of the USS Gerald R. Ford (CVN 78). » 22 juillet 2017.
[06] The Guardian. « Donald Trump complains he has not been awarded Nobel peace prize. » 22 septembre 2023.
[07] Associated Press. « Trump says he deserves Nobel Peace Prize, but he won’t get a fair shot at one. » 22 septembre 2023.
[08] Foreign Policy. « Trump’s Nobel Prize Fever Dream. » 9 octobre 2020.
[09] The Hill. « Trump nominated for Nobel Peace Prize for Abraham Accords. » 9 septembre 2020.
[10] U.S. European Command. « USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group on Scheduled Deployment in EUCOM Area of Responsibility. » 2 mai 2023.
[11] Le Monde. « Le « Gerald-R.-Ford », plus grand navire de guerre au monde, fait une escale très politique en Norvège. » 24 mai 2023.
[12] USNI News. « USS Gerald R. Ford Now Operating in Norwegian Sea. » 2 juin 2023.
[13] NATO Allied Air Command. « NATO and Partner air forces side-by-side in Arctic Challenge Exercise 2023. » 29 mai 2023.
[14] Center for Strategic and International Studies (CSIS). « The Ice Curtain: Russia’s Arctic Military Presence. » 25 mars 2020.
[15] Council on Foreign Relations. « The Arctic: A New Frontier for U.S.-Russia-China Competition. » 12 juillet 2023.
[16] The Economist. « The great-power contest for the Arctic is heating up. » 16 mai 2023.
[17] Wilson Center. « China’s Arctic Ambitions and the New Geopolitical Realities in the Far North. » 15 juin 2023.
[18] Brookings Institution. « The Trump doctrine: A chaotic, transactional, and hyper-nationalist foreign policy. » 14 janvier 2021.
[19] CATO Institute. « Assessing the Trump Doctrine. » Hiver 2020/2021.
[20] Foreign Affairs. « The Trump Doctrine, RIP. » Janvier/Février 2021.
[21] Chatham House. « Trump and NATO: The End of the Transatlantic Bargain? » Juillet 2020.
[22] The New York Times. « For Trump, a Nobel Prize Is a Long-Sought Trophy. » 11 septembre 2020.
[23] The Jerusalem Post. « Netanyahu recommends Trump for Nobel Peace Prize. » 28 septembre 2020.
[24] The National Interest. « Peace Through Strength: The Core of the Trump Doctrine. » 18 mai 2020.
[25] Foreign Affairs. « The Biden Doctrine. » Mars/Avril 2021.
[26] U.S. Department of State. « The Biden-Harris Administration’s National Security Strategy. » Octobre 2022.
[27] The Atlantic. « Trump’s NATO Rants Get Results. » 12 juillet 2018.
[28] White House. « National Security Strategy. » Octobre 2022.
[29] Carnegie Endowment for International Peace. « The End of the Grand Bargain: How Trump Has Changed U.S. Foreign Policy. » 23 juin 2020.
Voir également : « The USS Gerald R. Ford in the Norwegian Sea » — (2025-0828) —
In depth Analysis:
What is the strategic significance of the USS Gerald R. Ford’s deployment in the Norwegian Sea in August 2025? While stylistic differences exist between the Biden and Trump administrations, a fundamental continuity in American foreign policy—centered on military power projection and great power competition—persists. Joël-François Dumont dissects here Donald Trump’s « Peace through Strength » doctrine, highlighting its transactional nature and his personal quest for the Nobel Peace Prize as a validation of his anti-liberal approach to international relations. Both Biden’s or Trmp’s administrations, despite radically different styles, consistently employ military power projection as a core instrument of U.S. foreign policy. The fundamental divergence lies in the objective of this power: Biden seeks to uphold the liberal multilateral order, while Trump aims to dismantle it for transactional, unilateral gains. The USS Gerald R. Ford thus serves as a potent symbol adaptable to two contrasting visions of global engagement, while addressing enduring strategic imperatives, particularly confronting Russia in the Arctic.